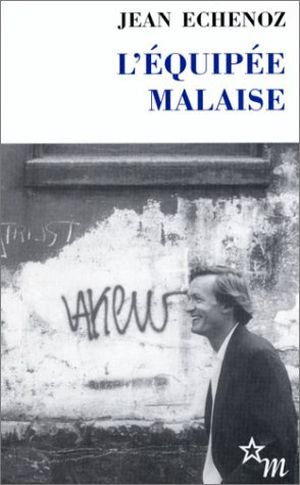La « subversion du roman »
On trouve en appendice de certaines rééditions de ce livre la reproduction d'une critique du journal Le Monde datée du 9 janvier 1987. Le chroniqueur, Pierre Lepape, y explique que L'Équipée malaise est une forme de « subversion du roman » : « tout, précisément, dans ce livre, se joue à côté, avec ce tout petit décalage qui fait que rien jamais ne colle, sans qu'on puisse dire précisément à quel moment, dans quelle marge, se sont produits les gauchissements, quand on a décroché de la réalité – de ce qu'on nomme réalité dans les romans – pour se retrouver dans une sorte de no man's land où rien ne va plus, où les vêtements sont trop petits ou trop grands, où les images ne correspondent pas aux paroles qui les accompagnent, où les conséquences et les causes qui devraient les produire ne s'enchaînent pas vraiment. » Élégante façon de dire que L'Équipée malaise est un roman absurde, dans son histoire, et dans son traitement. Jean Échenoz, qui a depuis cette époque affirmé son style à travers de nombreuses histoires à la fois comiques et romanesques, est un peu le chaînon manquant entre Eugène Ionesco et Robert Louis Stevenson, une sorte d'auteur multi-styles ambitionnant rien de moins que de redéfinir le romanesque.
Subversion, donc : L'Équipée malaise raconte n'importe quoi. À l'origine, il y a ce type, Pons, qui, pour garder la direction d'une plantation en Malaisie, décide de faire éclater une révolution et commande un stock d'armes de France. Lui, comme la grosse dizaine d'autres personnages centraux, sont décrits par le détail dans les deux premières pages du livre, de manière succincte et détachée. Après quoi, le carnaval peut commencer. Bien que l'histoire reste logique, la façon dont elle est racontée est faite pour déboussoler le lecteur, qui se raccroche à ce qu'il peut pendant que l'auteur, lui, s'amuse à faire de jolies phrases. Des années peuvent passer en une phrase ; la sonnerie d'un téléphone peut prendre une page : « Innombrables, étonnamment variées sont les sonneries téléphoniques de par le monde. Pour s'en convaincre il n'est pas nécessaire de sortir de chez soi, il suffit d'appeler l'étranger. Tout de suite se succèdent quelques tonalités. Quand on appelle au-delà des mers, on perçoit même un instant le bruissement de tel ou tel océan, aussi calme qu'une bête bourrée d'arrière-pensées. Puis cela vibre plus ou moins au loin, on perçoit le reflet d'une sonnerie déteint par la distance, pâle comme la photocopie d'une photocopie : c'est assez pour se faire une idée, assez pour s'assurer que selon les climats sous lesquels il dérange, le téléphone sonne sur divers tons, selon multiples rythmes. À l'opposé, par exemple, de nos longues stridences vertes, les appareils anglais procèdent par séries binaires de brefs bourdons bruns, les finnois crépitent sans nuance dans le pourpre et les malais distillent d'interminables grelottis blanchâtres, invertébrés, presque transparents. »
C'est comme ça pendant tout le livre. C'est drôle, de cet humour lunaire et lettré qui a fait les beaux jours de Pierre Desproges et Raymond Queneau. C'est insensé, car quand on arrive à lire entre les lignes et qu'enfin on comprend de quelles péripéties il est question, on ne peut s'empêcher de se demander où veut nous mener Echenoz : ses personnages sont en roue libre, soumis à la volonté seule de sa plume, qui les prend, les jette, les récupère dans une danse gentiment capricieuse. Ce n'est jamais violent, jamais sérieux, jamais choquant. Rien ne se joue pour de vrai. Les choses importantes sont celles auxquelles on donne de l'importance, et ce choix est toujours arbitraire, selon l'humeur du moment. Forcément, c'est un peu fatigant, un peu comme quand on lit un album de BD et que les images sont noyées sous le texte : il y a des mots partout, et leur sens, au fond, n'importe que peu. Ce qui compte vraiment, ce sont les motifs qu'ils dessinent, la manière dont ils sonnent à l'oreille. Telle entreprise aurait pu rapidement se dégonfler, surtout sous la plume d'un auteur prétentieux. Mais Echenoz n'est pas de ceux-ci : c'est un dilettante, au sens premier du terme, un personnage qui écrit parce qu'il en a envie et qui ne fait pas ça pour prouver quoi que ce soit. Peut-être plus que dans ses autres romans, il fait mouche parce qu'il pousse vraiment à l'extrême son art de dire ce qu'il veut. C'est donc fatigant, oui, mais sainement fatigant. Et, parfois même, émouvant, quand on comprend que cette légèreté n'existe, évidemment, qu'en surface. Car quel meilleur moyen, parfois, que d'être profond en s'interdisant de l'être...
Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.