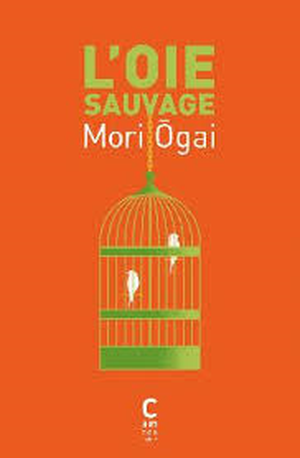Imaginez une très jolie fille, qui devient la protégée d’un usurier en mal de chair fraîche. Un usurier implacable et qui pourtant devant la naïveté de la belle se met à avoir des douceurs de jeune premier. Une belle naïve qui pourtant ne regarde pas sans concupiscence le charmant étudiant qui passe tout les matins devant sa fenêtre. Un charmant étudiant qui la dévore des yeux, et qui pourtant ne lui adresse jamais la parole. Quelle ronde des apparences trompeuses dans le Tokyo si déstabilisant des premières années de Meiji !
Oh, imaginer finalement n’est pas si difficile, a l’air de nous dire Ogaï dans son étonnant roman, non le compliqué, c’est de raconter. Raconter une situation qu’aucune personne en train de la vivre ne connait complètement. Raconter ces émotions qu’on ne parvient pas à retenir, ces changements d’humeur qu’on ne parvient pas à comprendre, ces lâchetés qu’on ne parvient pas à combattre. Narrateur omniprésent, et omniscient, Ogaï se promène parmi ses personnages avec l’ironie d’un lutin, suffisamment proche pour tout voir, suffisamment distant pour ne pas prendre parti.
En maître de la parole, du dit qui recrée, il joue avec les perspectives, les comparaisons, les conventions, pour montrer sans en avoir l’air qu’aucune histoire n’a de valeur en soi : tout dépend d’où on la voit et de comment on la relate. Et lui fait ça avec une impertinence (oh ce dernier paragraphe digne de Diderot, Sterne et Cervantès réunis !) assez étonnante pour un romancier japonais de 1911, comme si après avoir fait appel à toutes nos envies de compassion, il soufflait sur son château de cartes pour nous rappeler que la vie, après tout, n’est pas plus réelle qu’un roman, et répond aux mêmes règles du jeu. Et que pour vivre une bonne vie, ou pour écrire un livre réussi, l'important est de savoir regarder, certes, mais surtout, après coup, de savoir raconter.