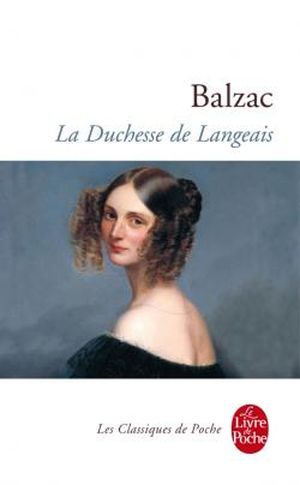Se lancer dans une critique d’un opus de La comédie humaine c’est certainement vouloir péter plus haut que son cul pour quelqu’un qui comme moi est loin de l’avoir bien explorée et encore plus éloigné de l’avoir comprise, c’est certain aussi. Et c’est surtout s’attaquer à un Everest de la littérature FR, ainsi risquer de raconter des vilénies. Mais bon, au calme devant l’ordi, casque vissé, sublimes concertos pour violoncelle, orchestre à cordes et basse continue de Vivaldi, ça mousse..
Hugo et Marx adoubèrent Balzac comme figure tutélaire de la sociale versant littéraire, écrivain de gauche dirait-on aujourd’hui, l’égalitarisme sacro-saint, inexistant au XIXe, en moins. D’autres, moins attentifs, en firent l’amiral de la racaille réactionnaire écrivante, puisqu’il vira monarchiste. Venons-en au fait : le cœur de ce roman palpite dans sa partie traitant de l’histoire politique des Bourbons, le reste n’étant qu’une onctueuse sauce romanesque des idées qui y sont développées. Il serait un tantinet taquin de dire que la lecture pourrait s’arrêter après ce chapitre ;)
D’une main et dans l’avant-propos de La comédie humaine, Balzac affirme que « Le christianisme et surtout le catholicisme étant un système complet de répression des tendances dépravées de l’homme, est le plus grand élément d’Ordre social ».
De l’autre, son œuvre (de ce que j’en connais) est un hommage désespéré au culte de l’argent-roi substitué au culte du Dieu et de son royal lieutenant terrestre. Hommage, car chez Balzac ceux qui s’y adonnent réussissent généralement bien. Faisant fi de la loyauté, de l’honneur, du courage, le Pouvoir s’offre systématiquement comme une vieille catin à ceux qui peuvent payer : « Il a 300000 livres de rente, il est pair de France, le roi l'a fait comte ». Visionnaire : encore et surtout aujourd’hui, qui, dans nos pays, peut prétendre gagner une élection majeure sans aligner des sommes absolument extravagantes ? Au cœur de cette modernité née dans la première moitié du XIXe trône en tyran la figure repue du bourgeois : le dimanche au bénitier, les autres jours à accaparer les richesses, des autres de préférence. Début du capitalisme triomphant, ravages de l’argent-roi, bourgeois dégoulinant d’affairisme, les rejetons joufflus et goutteux de 1789 se portent décidément bien.
Au mitan, une aristocratie dépravée devenue nulle avant de devenir rien, vendue à la bourgeoisie, dont La duchesse de Langeais est une des effigies. Les aristocrates se voyant tous égaux par leur faiblesse se croient tous supérieurs, « chaque famille ruinée par la révolution, ruinée par le partage égal des biens, ne pensa qu’à elle, au lieu de penser à la grande famille aristocratique, et il leur semblait que si toutes s’enrichissaient, le parti serait fort. ».
Et pour s’enrichir l’aristocrate javellisé se met servilement à la remorque de celui qui fait le blé : le bourgeois. Dès lors il ne mérite plus sa prétention au pouvoir.
La vision balzacienne du désastre aristocrate et avec lui de celui du pays tient en deux phrases du roman : « le costume général des castes patriciennes est tout à la fois le symbole d’une puissance réelle, et les raisons de leur mort quand elles ont perdu la puissance. Tout devrait élever l’âme de l’homme qui, dès le jeune âge, possède de tels privilèges, lui imprimer ce haut respect de lui-même dont la moindre conséquence est une noblesse de cœur en harmonie avec la noblesse du nom ». Ce désastre est d’abord moral.
Les déconvenues de la duchesse et de ses pairs ne sont finalement qu’une illustration fictionnelle de cette aristocratie vaniteuse, corrompue par l’orgueil, que Balzac ne cessait de conspuer, avec en point d’orgue dans ce roman le clash entre noblesse d’Empire, méritante, désintéressée et patriote, et noblesse d’ancien régime devenue perfide et humiliante. On retrouvera des tensions similaires dans Le colonel Chabert.
Balzac en partisan du trône et de l’autel considérait l’aristocratie (et l’église) comme une nécessité sociale dont la chute fut entamée dès l’avènement de Louis XV. Conscient de l’ambivalence de Balzac, Victor Hugo déclarait lors de ses obsèques : « À son insu, qu’il le veuille ou non, qu’il y consente ou non, l’auteur de cette œuvre immense et étrange est de la forte race des écrivains révolutionnaires. ». Admettons qu’une contre-révolution est une forme de révolution.. On peut aussi estimer que Victor Hugo fit un peu de récup.
Sans ces soubassements essentiels, La duchesse de Langeais irait rejoindre sur l’étagère les petits romans à l’eau de rose, entre Barbara Cartland et Foenkinos, le panache et l'humour en plus, ça va sans dire. Mais, et heureusement, cette chronique sur la vengeance puis les regrets d’un amant éconduit est, dans le fond, une bonne diatribe contre une aristocratie indigne de son rang, coupable (selon l’auteur) de tous les maux dont la France souffre puisqu’elle l’abandonna aux griffes du bourgeois affairiste. Toute ressemblance avec des personnages existants etc..