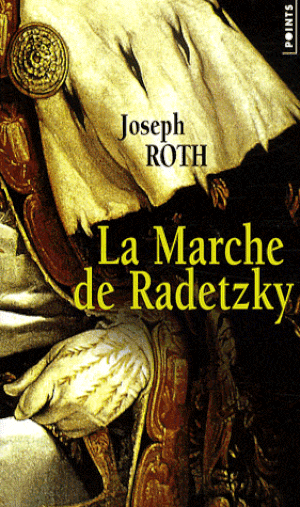Nous voilà en présence du miroir austro-hongrois des tourments italiens du Guépard de di Lampedusa, ou du Monde d’hier selon Zweig, il y a dans ce roman une musique souffrante et ténébreuse qui sert de guide dans le capharnaüm des pourrissements d’Empires. Joseph Roth dépeint l’amère chronique d’un système social convaincu de son immuabilité, de sa verticale perfection, mais qui devra tirer sa révérence, âge fatidique oblige. Alors oui, le tableau est transposable à toutes époques et toutes géographies, on a toujours une vie derrière soi pour le rappeler.
Bossuet le dit si bien : « Si je jette le regard devant moi que d’espaces infinis où je ne suis pas, si je le retourne en arrière que de suites effroyables où je ne suis plus, et que j’occupe peu de place dans cet abîme immense du temps ». Roth n’explique rien, il ironise seulement, même s’il ironise jaune, sur le peu de place qu’occupe dans le temps et dans l’espace une réalité sociale, quelle qu’elle soit, face à la mort inéluctable de ses composants intimes.
En effet, si l’idée impériale meurt de la première à la dernière page du roman, c’est bien la mort des personnages clés mis en scène par l’auteur qui matérialise celle de l’Empire. La grande mort, de l’Empire et de l’Empereur François-Joseph, n’a de réalité tangible qu’au travers la décomposition des corps qui les composent. En somme Roth théorise, sans faire œuvre d’historien ou de sociologue (c’est de la littérature, dieu merci), que la désagrégation d’un Empire commence par celle de sa base, par les petits gestes quotidiens du vulgum pecus. Le pourrissement moins par la tête que par le bas.
Il n’y a pas d’amor fati chez Roth, pas d’éternel retour, et il n’existe rien derrière l’Empire. L’après et le pourquoi ne sont pas son sujet. Chaque décès, d’un soldat, d’un médecin, d’un concierge, désarrime les survivants de l’immuabilité impériale et les contraint à se positionner par rapport à leurs propres finitudes, à réfléchir par eux-mêmes. La psychologie du survivant n’évolue pas au fil des années, ce sont ses valeurs qui se transforment par l’action directe de la disparition de ses référents immédiats sur le cours de sa vie, jusqu’à délégitimer l’ordre établi, puisque finalement tout passe. Mais la délégitimation n’a pas de visée émancipatrice, révolutionnaire, festive ou de bâtisseurs, elle est comme du sable fin qui s’écoule entre les doigts sans que rien ne puisse l’interrompre... L’émancipation, pour quoi faire ? lit-on en filigrane. Et pourtant elle est portée par chacun des plus fidèles de l’Empire. Par l’Empereur lui-même.
Finalement, sur un thème assez commun en littérature depuis l’Enéide, Roth pose un regard singulier sur la transformation des sociétés. Au travers de petites actions du quotidien d’une population relativement éloignée des élites, il pense la légitimité d’un ordre établi par un héritage qu’il est difficile de conserver sur la durée et par l’idée que se fait l’élite elle-même de l’ordre qu’elle concoure à établir ou à maintenir. Roth dissèque les vacillements intérieurs.
Quand le survivant finit seul, que les morts qu’il pleure constituent son horizon final, la légitimité de l’Ordre, de son point de vue de survivant hagard se regardant au miroir terni, s’étiole.