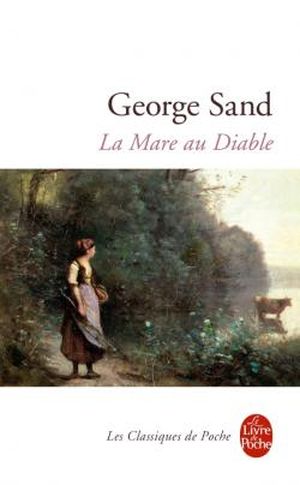Mais alors qui s’est dit que résumer La Mare au Diable (1846) à l’histoire d’un paysan qui s’en va chercher une femme avec qui se marier suffisait ? L’histoire « si courte et si simple », pour reprendre les mots de George Sand, est selon moi sacrément mièvre. Mais, à la lumière des propos d’ouverture de l’autrice, la mièvrerie devient douceur et bonté véritable. Je m’explique. A travers la référence à une gravure d’Holbein (swip), Sand critique la tradition artistique qui veut que seule l’image de la mort et du malheur parvienne à rendre moralement bon. Elle souligne la vision noire qu’avait le peintre sur la société de son époque, dénonce la tristesse et la peur qui en résulte et aspire à un regard renouvelé sur des spectacles souvent dépeints comme misérables. Il lui semble nécessaire de rendre l’homme sensible aux douleurs du plus pauvre pour permettre le développement d’une société moins égoïste.
La tombe ne doit pas être un refuge où il soit permis d’envoyer ceux qu’on ne veut pas rendre heureux.
L’art apparaît alors pour elle comme « une recherche de la vérité idéale ». Dans cette optique, Sand s’attache à raconter les humbles péripéties de Germain avec tous les bons sentiments que cela implique ; d’où cette sollicitude constante des personnages les uns envers les autres. Sans cette préface, l’histoire m’aurait certainement beaucoup moins touché que ce ne fut le cas ; d’autant plus que l’œuvre se termine par un appendice sur les traditions attachées aux noces dans les campagnes qui, bien qu’enrichissant, s’avéra un peu ennuyant.