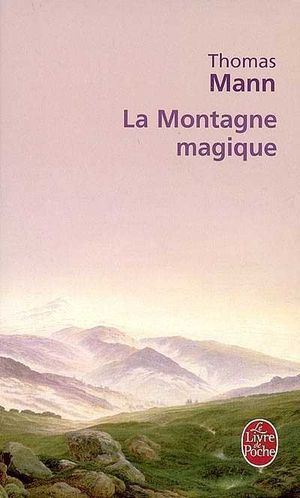Sous la plume réglée de Thomas Mann, la montagne n'est pas juste un théâtre, un sanctuaire, le refuge des malades et des mystiques. Elle est, plus prosaïquement, un espace socialement distingué de la plaine, en vérité un contre-monde clairement distingué du monde. « Hors du temps » comme nous le lisons parfois ça et là, mais également – nous sommes tentés de le dire - hors du Siècle comme l'est un monastère. Ses hôtes y mènent une existence « étroite » (c'est-à-dire enclose) et « régulière » (c'est-à-dire forgée dans la Règle), physiquement limitée au sanatorium du Berghof et au village de Davos.
Hans Castorp, admis presque malgré lui comme convalescent à long terme, y expérimente la plasticité du temps. Voilà semble-t-il le cœur du propos. Le quotidien des cures se déploie dans une reproduction infinie des mêmes rituels, des mêmes gestes et des mêmes fréquentations. Si cette monotonie, pour lui, étire l'instant de prime abord, tresse les heures de longues minutes, et les journées de longues heures, la sensation de l'écoulement se contracte brusquement sitôt le regard jeté sur ce proche passé. Rien au monde n'aura semblé plus court que ces quelques semaines consumées dans le vide, partagées entre les six services quotidiens de l'hôtel et les repos obligatoires dans l’exiguïté des balcons et la solitude des vallées alpines. En somme le temps, quoique long, ne fait point sentir sa durée réelle. Les jours, semblables aux autres, ne s'additionnent guère mais se confondent. Ils sont tous une seule et même journée, un « présent immobile », une « éternité » atomisée. Dans le Zauderberg, le temps est un dieu pauvre qui meurt de sa lente mort lorsque manque son pain de vie. Il se dévore lui-même. Et le style de l'auteur, la forme même de sa narration épousent cette étrange alternance du long et du court. Quelques 200 pages auront été nécessaires pour décrire les trois premières semaines du séjour de Hans Castorp. 600 pages suffiront à balayer les sept années restantes. Les mots ne sont pas seulement le foyer du sens, mais également celui du temps, battant sa mesure d'abord lentement, puis au pas de course, enfin d'un rythme vague et indistinct. C'est un grain de sablier que le génie narratif pétrit selon sa fantaisie, et nous savons le culte que l'auteur voue à ce génie-là, qui dans L'Elu ébranlait toutes les cloches de Rome pour le seul plaisir de son divertissement, et qui frôle ici de sa main invisible les aiguilles de l'horloge humaine.
Nous aurions tort pourtant de croire que ce temps suspendu puisse être, seul, un sujet propre. « Pourrait-on raconter le temps en lui-même, comme tel et en soi ? » demande l'auteur, feignant l'ingénuité. Plus fascinant est l'effet qu'il produit sur les « gens d'en haut ». Couvrant tout de sa chape, il semble fixer dans les corps bercés de ses flots paresseux des mouvements intérieurs que la dynamique du « plat pays » ne permet pas de connaître intimement. Les souffrances et les passions que suscitent Clawdia Chauchat sont ainsi plus profondément ressenties par Hans. Elles ne peuvent simplement le traverser, au contraire, elles jettent l'ancre au port de son âme, se laissent contempler comme de lascives divinités, tantôt supplice, tantôt jouissance. Quel contraste alors entre le puissant effet de ces rares interactions, et leur dimension tout à fait banale, insignifiante. Ce regard indifférent de Clawdia sur les chaussures du jeune homme, ce « bonjour » cordial échangé à la croisée des chemins, ces yeux promenés sur une mauvaise toile figurant la belle malade, sont autant de cercles traversés du Paradis et de l'Enfer, autant de ponts dressés au-dessus de l'abîme. « Ô jubilation, triomphe et exultation infinie ! Non, Hans Castorp n'aurait pas cette ivresse d'une satisfaction fantastique auprès de quelque petite oie blanche et saine à laquelle il eût, là-bas, au pays plat (...), donné son cœur ». À l'altérité du temps suit l'altérité des sens, et au contact de Clawdia le cœur du jeune homme « cesse de battre » au lieu de s'emballer comme il l'eut fait « en bas ».
L'introspection statique s'ouvre ainsi comme un gouffre profond où le jeune homme s'enfonce à pas nonchalant, jusqu'à s'y perdre naturellement. Introspection physique d'abord, celle du corps que l'angle strict des sciences médicales guide par glandes et muqueuses, puis une certaine philosophie de l'existence – individuelle et collective, spirituelle et politique – que nourrissent de leur verve intarissable ses deux mauvais génies : Naphta et Settembrini, le jésuite gagné aux idées de Marx, pour improbable que soit cette association, et le franc-maçon libre-penseur, le spectre de Thomas d'Aquin et celui de Jean-Jacques Rousseau toujours s'affrontant sans que l'épée de l'un n'abatte l'écu de l'autre. Combien serait difficile de rendre par ces quelques lignes toute la virtuosité des joutes oratoires que mènent avec hargne deux esprits si robustes et structurés ! Mais combien il serait vain d'y parvenir malgré tout si nous ne comprenions à temps que ces disputes, aussi brillantes soient-elles, ne concourent nullement à élever l'esprit de leur pathétique écolier, mais accélèrent plutôt sa chute dans un présent marécageux.
La sublime détonation de Mynheer Peeperkorn parvient, seule, à secouer le joug des deux professeurs sur cette âme voguant dans les sèches garrigues des humanités. Ce planteur de café rescapé de toutes les mers du globe, ivrogne et bégayant, est réellement un personnage formidable, d'une vitalité extraordinaire et immédiatement perceptible, tout spécialement dans sa gestuelle maladroite et souveraine, où niche l'essence de son langage et de son magnétisme. C'est un pain travaillé dans la farine d'or du soleil, un homme qu'on a guère besoin de comprendre - et qui d'ailleurs ne fait rien pour être compris - mais dont on subit l'étrange attractivité, le chaleureux entrain, l'enivrante musique du cœur. Il débaroule au sanatorium comme Bobi débaroule à la ferme de Jourdan dans le roman de Jean Giono, Que ma Joie demeure, c'est-à-dire comme un homme attendu malgré soi, pour dissiper les brumes d'un songe mortifère. Il y a chez lui quelque chose de très « nietzschéen », si l'on me passe l'expression, en ce que sa force et son instinct dominant résultent d'une obscure évidence. Il est réellement « l'homme doué d'une volonté propre, indépendante, longue, qui a le droit de promettre - et en lui la conscience orgueilleuse, qui fait vibrer tous ses muscles, de ce qui a fini par être conquis et par s'incarner en lui, une véritable conscience de sa puissance et de sa liberté, un sentiment d'accomplissement de l'homme en général » (Généalogie de la Morale).
Et soudain le temps sans durée reprend ses bacchanales. Ayant déjà largement contaminé l'esprit de Hans, il jette sur nous, lecteurs, son damné sortilège. Déjà les interminables débats de Naphta et Settembrini se sont abolis dans leur fausse durée. Rien ne nous reste, ou presque, quoique leur docte verbiage a noirci peut-être des centaines de pages. En revanche combien longue et vivante nous paraît cette joyeuse parenthèse que Mynheer Peeperkorn a ouverte comme un jour de solstice, et qui pourtant n'occupe que trois maigres chapitres. Que de temps nourri, épaissi, levé comme une pâte à la chaude cuisson des humeurs dansantes de l'homme « à la fossette de sybarite » ! Et quel vide laissé par sa brusque disparition ! La morne temporalité du sanatorium reprend ses droits, et voilà Hans tombé dans « l'Hébétude », comme une étape nouvelle dans son chemin de mort. Son corps déjà se façonne dans l'inertie du sépulcre, mais un phonographe tonne soudain dans cette poitrine en berne l'ultime pulsation. L'âme sevrée du jeune homme goutte à nouveau dans l'artifice musical, simulacre odieux de vie et de temps, le précieux lait maternel. Il s'arrime aux voix mêlées de l'Opéra italien et du lyrisme allemand, comme Grigors arrime ses lèvres au sein tellurique de sa pénitence lacustre dans l’Élu. Leur vie à tous deux se réduit alors à la portion congrue, et chacun "saute ainsi par-dessus le temps et le supprime".
Il n'y aura vraiment que la guerre pour ramener Hans dans le giron des cycles, et c'est l'occasion pour Thomas Mann de proclamer toute la profonde affection qu'il garde à l'endroit de son triste et pathétique héros. La guerre ici n'a rien de tragique en soi, bien au contraire elle est une tragique bénédiction. Aucune puissante nécessité ne la charrie, elle est une conjoncture hasardeuse, une variable parmi d'autres du réel tourbillonnant, de ce réel dont Hans s'est extirpé trop longtemps et qui le rappelle brusquement sous le fracas des bombes. Cette guerre que l'auteur qualifie de « fête de la mort » (Weltfest des Todes) est alors bien réellement une « fête ». Elle annonce le retour de Hans à la vie. Elle est un événement qui, sans équivoque possible, mérite d'être célébré en grande pompe, fusse dans la sale ornière des tranchées. Il est rappelé à son devoir, qui n'est pas de servir sous les drapeaux, mais de vivre tout simplement, malgré l'audace terrible de cette tentative.