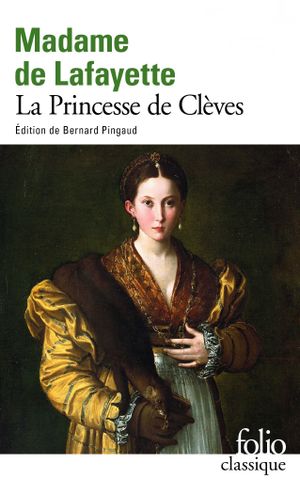Oui, j’aime les jeux de mots pourris, soit.
Bon, je ne peux pas dire que je suis déçu de la lecture de ce roman car je n’en attendais rien (je précise quand même que j’aime beaucoup lire) mais je ne l’ai tout de même pas apprécié. Je vais quand même essayer de développer sur les différents points du livre qui m’ont déplu.
Tout d’abord, j’ai ressenti une certaine lassitude et un certain ennui tout au long du récit, en partie à cause du fait que les situations semblent d’étirer inutilement (ce n’est qu’un exemple mais a-t-on vraiment besoin d’une scène d'exposition de plusieurs dizaines de pages qui nous présente l’intégralité de la Cour alors que 80 % des personnages présentés seront inutiles par la suite ?) mais aussi à cause du fait que j’ai eu l’impression d’avoir vu ou lu ce genre d’histoires de nombreuses fois et que celles-ci me paraissaient beaucoup plus intéressantes (même si je le concède, ce point est discutable car chronologiquement parlant, je pense plutôt que c’est la Princesse de Clèves qui a pu inspirer certaines oeuvres partageant le Topos de l’amour impossible ou du triangle amoureux). Néanmoins, j’ai aimé quelques passages du livre comme l’histoire de la lettre avec le Duc de Nemours et le Vidame de Chartres ou encore la scène de l’aveu (même si je la trouve trop longue dans sa globalité).
Un autre aspect de l’oeuvre qui m’a dérangé est ce qui concerne la morale du livre. En effet, elle s’inscrit dans la morale religieuse Janséniste (pour faire simple, il s’agit d’une doctrine religieuse très austère qui défend l’idée que l’Homme est prédestiné au péché, au vice, un joyeux programme en somme). Ainsi, les personnages masculins sont dépeints de façon très manichéenne, par rapport au vice et à la vertu, il sont soit la représentation de l’inconstance masculine, d’un homme impliqué dans plusieurs relations (coucou le Vidame de Chartres) ou soit un modèle de vertu (coucou le Prince de Clèves), du coup c’est assez dérangeant car il n’y a pas de nuances par rapport aux personnages masculins. Du côté de la Princesse de Clèves, sa mère lui dit quand même que la seule personne qui lui permettrait d’avoir une vie paisible et heureuse, c’est son mari (cringe bordel). La fin du récit est tout de même très moralisatrice je trouve, les moeurs de l’époque me diriez vous.
Du coup, à la fin de ma lecture je me suis posé cette question : Pourquoi imposer cette oeuvre au programme de première alors que certains élèves ont déjà du mal à accrocher sur la lecture d’oeuvres intégrales ?
J’y ai finalement réfléchi, et je pense que c’est surtout son statut d’oeuvre pionnière qui fait tout son intérêt car il s’agit de l’un des textes qui se rapproche le plus du roman tel que nous le connaissons aujourd’hui. Ainsi, c’est plus la place importante qu’il occupe dans l’histoire de la littérature française qui est intéressante plutôt que le texte en soit.
En conclusion, La Princesse de Clèves a été une expérience littéraire singulière, où le contexte de l’oeuvre et sa place dans l’histoire de littérature m’ont plus intéressés que l’oeuvre en elle-même.