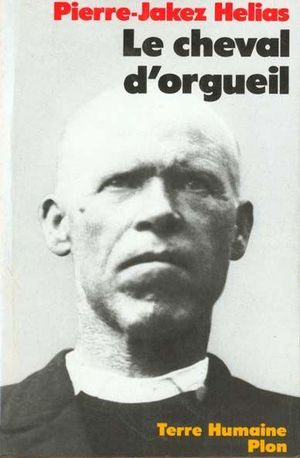Etonnant témoignage : on retourne en pays Bigouden à l'avant-guerre pour y ausculter le fonctionnement de la société paysanne bretonne. Ni vraiment compte-rendu ethnographique, ni vraies mémoire, il approche, comme le défend l'auteur par un courrier à son éditeur, du genre du témoignage.
Car en réalité, la mémoire de l'auteur ne sert que d'un mortier pour consolider la cathédrale du souvenir ce la société bigoudène disparue. Il l'avouera à la toute fin, il a passé trois ans à interroger les paysans de son pays et porteurs de la mémoire que le seul écrivain ne pouvait mobiliser.
Il convient en premier lieu de rappeler l'accueil qui a été fait au livre à sa sortie. La majorité des critiques ont porté sur le statut de l'enquêteur, à la fois Bigouden et intervenant extérieur d'apparence scientifique. Ayant quitté la glèbe pour devenir journaliste et écrivain à Paris, il y a grandi mais a perdu ses entrées, de sorte que ses souvenirs "de première main" ont besoin d'être soutenus par ceux des indigènes. Dès lors, quelle valeur accorder à cette première main si une telle mémoire ne suffit même plus à accéder au coeur de l'expérience de la vie à la campagne Bigoudène ? Pourquoi l'auteur avoue-t-il lui-même qu'il n'a pas réussi à obtenir la confiance de ses interlocuteurs, malgré le breton qui est sa langue natale ? Malgré ce relatif aveu d'échec, Hélias dessine une immense fresque polluée par quelques longueurs et quelques redites, qui comporte ses personnages, ses héros et ses vilains. On le lit comme un voyage au ralenti dans un immense musée de cire, comme si le temps s'était figé une matinée venteuse de 1911.
L'autre source de discorde dans ce livre sont les enseignements qu'Hélias tire de la disparition du monde de son enfance. L'ethnographe ne décrit pas seulement le monde qui l'a créé, il tente de comprendre sa destruction et les forces qui y ont présidé. Dès lors, il dépasse son rôle de chroniqueur pour livrer une charge féroce contre l'avidité et son cheval de Troie, le progrès technique. En France, ce dernier a pris une forme centralisée et Marshallisée qui ajoute au ressentiment breton, habitués à voir les Érinyes parisiennes semer le trouble et répandre le sang dans leurs sillons. 5 siècles d'affrontement suffisants pour qu'Hélias dépose sa réserve de chercheur et accuse ce sentiment bourgeois du confort qui pousse les gens à acheter des objets inutiles et à s'endetter, il peste contre les objets fabriqués pour être jetés, des gens qui ont décrété que la misère existait en-dessous d'un seuil et qu'il était nécessaire de disposer d'un minimum d'argent, sous peine d'être pris en charge par la société. Cette terre, pourtant française depuis quatre siècle, possédait une société en bon fonctionnement qui fut tout à coup balayée par un rouleau compresseur de nature inconnue, qui emporta avec lui des traditions vieilles de plusieurs siècle.
Des traditions oui, le mot est central car il est le noeud, y compris sémantique, autour duquel se noue cette société de vieux bretons et sa survie. Car la tradition s'ignore en tant que tradition, mais dès qu'elle cherche à se préserver où à se conserver, c'est qu'elle est déjà en train de mourir et qu'elle en a conscience. Dès lors, accepte-t-on cet état de fait et acceptons-nous l'expansion du mouvement néo-breton des Diwan Skoll, de l'enseignement d'un breton standardisé, de l'explosion des festivals dits "celtiques", du tourisme et des Gwenn-Ha-Du (le drapeau breton) aux quatre coins du monde? Laissons-nous se figer la culture ancestrale en un folklore ? Autrement dit, la grand-mère bretonne de Plozévet doit-elle se laisser photographier par le français moyen venu dépenser sa paie annuelle lors de ces congés payés de l'année 75 ? En cet an où Hélias écrit, cette question est brûlante. D'un côté, la culture bretonnante fière porte encore la honte de la collaboration du Bagad Perrot, de l'autre, une jeunesse anti-jacobine se lève et tente, dans un cadre urbain, d'inventer une culture bretonne compatible avec ses aspirations de jouissance ou, disons le gentiment, d'épanouissement.
Un peu à l'écart, l'auteur ne renonce pas. Non, il ne renonce pas à son Acadie natale, à ce pays à la société dont les rapports sont devenus extrêmement sophistiqués, et même, comme lorsqu'il décrit le rituel de la visite à la ferme, raffinés. Mais il ne se résout pas à voir le gros lit de sont enfance, un vaste lit en bois qui ferme la nuit par quatre panneaux, au sommier en paille, dont le dessous sert de rangement et la partie supérieure ornée par des motifs religieux, partir dans un musée où être traqué par des parisiens voulant meubler leur maison de stylé néo-bretonne de la côte d'Armor. Il a beau être un bounty, un émigré, un crêpeux de la rue d'Odessa, il ne décolère pas de voir le bel édifice de jadis s'écrouler, en son absence de surcroît. C'est notre destin à tous, depuis les romains jusqu'à mon homonyme dans le Guépard.
Au pays Bigouden, on avait des coiffes. Alors l'image est restée, et la bretonne continue à bien se vendre. Mais les sociétés qui n'ont rien de marchandisables, elles, sont-elles condamnées ?