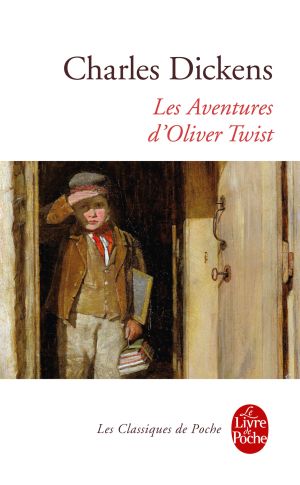Les critiques contemporaines de Charles Dickens, et particulièrement de son Oliver Twist, ont tendance à lui reprocher ses facilités scénaristiques et ses personnages très stéréotypés. Ce que de telles accusations ne prennent pas en compte est le format dans lequel le Britannique écrit : ces deux défauts ne sont imputables qu’à la forme assez coercitive du roman-feuilleton ; la nécessité de créer le suspense et de caractériser simplement les personnages pour ne pas perdre le lecteur d’une semaine sur l’autre.
Le cœur du problème est finalement ailleurs. Et pour cela, point question de mettre le roman-feuilleton en cause, mais bien plus l’auteur en lui-même. Car on ne peut pas excuser à Dickens de rendre son récit particulièrement racoleur. Comment fait-il ? En usant et abusant sans aucune retenue du registre pathétique, jusque dans les plus sombres recoins de sa narration. De manière adaptée dans certaines situations (comme le premier chapitre), mais par trop souvent si exploitée que ça en devient parfois grotesque (les derniers instants du Juif), souvent artificiel (la scène chez le magistrat au chapitre 3). Le pathos devient le cœur même de la narration, et il faut très peu de temps avant de n’être plus ému par rien du tout.
Autour de cette thématique Dickens en rajoute toujours plus avec un sens assez étroit de la pureté. Dans cette société de personnages aussi variés que le propos le permet, la construction n’est pas manichéenne dans le mauvais sens du terme mais sa construction est très claire : il y a les purs et les méchants. Les gentils/purs restent gentils/purs, les méchants restent méchants, certains méchants deviennent gentils (et encore, une, presque deux personnages seulement, sont concernés), mais jamais l’inverse. Non pas que les occasions s’y prêtent, mais c’est justement sur ce point que Dickens se montre aussi indigent que ses personnages : la tentation est une notion absente chez lui. Et pourtant l’occasion s’y prête lors du cambriolage auquel Sikes force Oliver, mais jamais la pureté de ce dernier n’est mise à l’épreuve, car elle est aussi naturelle qu’une Justine sadienne. Cependant là où Sade parvient à justifier son roman en mettant en scène l’inaliénable tortuosité du vice de la société, Oliver n’explore rien et son attitude ne se borne qu’à la surface de ce que peuvent exploiter les déportements littéraires du libertin français.
Les épreuves auxquelles on le soumet s’avèrent d’ailleurs finalement assez mineures par rapport à ce que la taille et la réputation du roman vendent. À peine deux chapitres consacrés à ses jeunes années à l’orphelinat, deux autres comme apprenti chez le croque-mort Sowerberry, une quinzaine dans la société du Juif et du Renard ; la deuxième moitié se consacre à son édification au sein une famille adoptive idéale, aux antipodes de la bienveillance délictueuse de ses premiers bienfaiteurs. Plus le récit avance, plus Oliver s’efface pour que M. Brownlow et Cie se placent au-devant de la scène. La quête identitaire n’est pas vécue par le héros mais menée par des tiers, ponctuée de deus ex machina délirants (bien sûr, Oliver tombe sur la seule personne capable de le reconnaître) ce qui fausse tout attachement à l’entreprise de la part du lecteur.
Il n'en faut pas plus pour se rendre compte qu’Oliver Twist est probablement un des romans les plus décevants de la littérature britannique du XIXe siècle. La critique sociale se noie dans cette sempiternelle quête littéraire du pathos, épisode par épisode, qui seyait probablement plus à un public soumis à une attente hebdomadaire fébrile, voire à Marx et Engels qui admiraient Dickens pour ce tableau presque naturaliste des classes défavorisées de la société anglaise. Franchement… Comment avoir pitié d’une classe représentée sous des avatars aussi véreux et orduriers ?
Pour le roman d'apprentissage, en plus cruel, on se rabattra sur Sade et sa Justine, Les Misérables pour la tortuosité criminelle et le réalisme social, et pour les mêmes période et nationalité, il reste bien évidemment Thackeray.