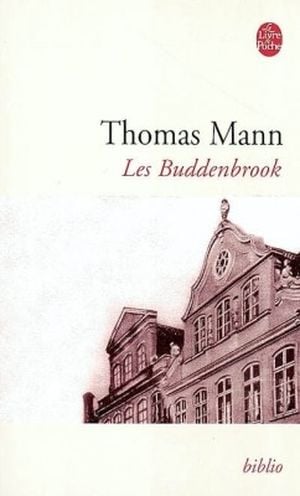Les Buddenbrook est le récit d'une chute, implacable, tragique, cruelle, mais également cohérente et presque logique, comme la chute qui intervient inévitablement après la plénitude obtenue dans le sentiment d'accomplissement et de prospérité, comme l'équilibre nécessaire à toute chose. Comme le veut désormais le roman moderne, Thomas Mann nous plonge in media res dans le récit, ouvrant son roman par une phrase de dialogue. La première partie saisit les Buddenbrook dans une véritable apogée, une insouciance heureuse qui transmet un sentiment de plénitude et de bien-être au lecteur, à travers une hypotypose constante, où le narrateur omniscient se glisse avec une légèreté extraordinaire dans les pièces de l'opulente et faste demeure familiale. Puis le doute s'immisce, lent, pernicieux, vampirise les personnages jusqu'à la déliquescence. Ce sont les échecs conjugaux de Tonie, le manque d'assurance de Thomas, l'hypocondrie de Christian. Et enfin, la sensibilité exacerbée, excessive de Hanno.
Sensibilité, c'est le dénominateur commun de tous les personnages. Le grand-père Buddenbrook, qui après la mort de sa femme, voit son monde s'éteindre doucement, ses repères se brouiller et s'effacer, n'en prend pas réellement conscience, et c'est encore une curiosité, une anomalie :
Il ne réfléchissait guère, mais, la tête un peu branlante, se bornait à jeter un regard en arrière sur sa vie et la vie en général ; combien lui paraissait soudain lointaine, étrange, cette agitation bruyante dont il avait été le centre, mais qui s'était insensiblement détachée de lui et dont son oreille tendue percevait avec stupeur les échos mourants...
Chez son fils, le premier consul Buddenbrook, la sensibilité est plus marquée encore, mais s'efface devant les obligations familiales, la foi aveugle et obstinée dans lequel il se réfugie, peut-être pour y échapper inconsciemment. Lorsqu'il délivre sa fille de son premier échec conjugal, il n'a jamais semblé aussi proche du lecteur, animé de sentiments profonds et sincères, humble, pudique et faillible, en somme, d'une humanité poignante.
Sa fille, Tonie est peut-être le personnage le plus beau de tous. Elle porte sur le monde un regard d'enfant naïf et idéaliste, traverse les événements sans vraiment les comprendre, avec des éclairs de lucidité parfois. Sa vie sera une succession de désillusions et d'échecs, mais son admirable abnégation à préserver sa dignité et le prestige de son nom semble transcender l'échec, en faire paradoxalement une victoire sur la cruauté de l'existence. Elle est le souffle de vie qui traverse et sublime les pages du roman, porteur d'un optimisme indispensable à l'équilibre de l'oeuvre. Et lorsqu'elle verse « ces sanglots d'enfants, spontanés, bienfaisants », salutaires, libérateurs, le narrateur s'efface, admiratif.
L'unique moment vraiment heureux de l'existence de Tonie, où sa spontanéité peut s'exprimer pleinement, est également l'une des scènes les plus réussies de l'oeuvre de Thomas Mann. C'est le baiser déposé par le jeune Morten sur les lèvres de Tonie, sur la côte de la mer Baltique, consécration d'un amour d'une pudeur et d'une grâce incroyables, et qui mourra avant même d'avoir pu prononcer son nom, sacrifié presque absurdement sur l'autel de la continuité et de la dignité familiale. Même si elle n'est jamais véritablement exprimée, la douleur de l'instant fugitif et perdu anime la suite du récit d'une mélancolie poignante.
Les deux fils du consul, Thomas et Christian, sont les deux faces de l'homme décadent et névrosé du début de siècle, qui s'opposent et se complètent. Christian, on le croirait sorti d'une nouvelle fantastique de Maupassant, lorsqu'il évoque un homme, fantasmé ou halluciné, assis sur son fauteuil, qui le salue lorsqu'il rentre chez lui. C'est le noceur névrosé qui tente d'échapper à ses angoisses par un goût immodéré du plaisir, mais la sensibilité, la volonté exacerbée de comprendre et d'accéder à son intériorité, lui est fatale et semble confiner à la folie.
Quant à Thomas, destiné dès sa naissance à incarner la continuité familiale, il voit émerger en lui la sensibilité déjà sous-jacente chez son père et ne peut lutter contre le sentiment constant de doute, d'incertitude et d'angoisse qui l'envahit et le vampirise progressivement ; c'est le personnage le plus pathétique de tous, celui qui prend conscience peu à peu, avec une implacable lucidité, de l'échec de ses tentatives désespérées de donner un sens à sa vie. Le tempérament artistique refoulé et inassouvi le gangrène, lui fait abhorrer la perpétuelle comédie humaine qu'il doit jouer s'il veut préserver le rang et la dignité des Buddenbrook. Il découvre Schopenhauer, semble un instant pouvoir accéder à une vérité intérieure et métaphysique, mais le poids du quotidien, celui d'un ordre immuable, l'écrase à nouveau et l'entraîne vers une dépression profonde, noire, fatale, que Mann souligne par des phrases grisâtres, désillusionnées, antithétiques du sentiment de gaieté et de plénitude qu'elles transmettaient lors des premières parties.
De l'union étrange de Thomas et de Gerda, femme fermée et secrète (Mann ne nous donne jamais accès à son intériorité), naîtra Johann IV, surnommé Hanno. C'est le personnage qui fut immédiatement la source d'identification la plus forte pour moi, par son malaise dans le cadre familial comme dans le cadre scolaire, son incapacité à communiquer et à se faire comprendre des autres. Le tempérament artistique s'exprime enfin pleinement chez lui, à travers la musique moderne, wagnérienne particulièrement, vectrice de décadence mais aussi de transcendance. Les deux seules véritables transcendances du roman, Hanno et la musique en seront effectivement les objets, dans deux analyses de philosophie musicale où Thomas Mann se révèle prématurément comme l'un des plus grands prosateurs de son temps. C'est ce qui a exercé l'influence la plus durable et pénétrante sur moi, le deuxième chapitre de la onzième partie, qui décrit une journée dans la vie du jeune collégien, une plongée dans une institution scolaire corrompue et sclérosée, une journée grisâtre, morne et monotone, illuminée néanmoins par les rapports tendres et affectueux de Hanno avec le jeune Caïus, où semble déjà poindre un peu plus que de l'amitié, une journée enfin qui s'achève dans une saisissante improvisation au piano, véritable orgasme musical qui contient à lui seul la vie et la mort, le commencement et la fin, et dont, si l'on me pardonne l'audace de la comparaison, le flamboyant A Day In The Life des Beatles me semble être un lointain cousin.
Il y avait comme une insistance obtuse et comme une ferveur ascétique, comme un mélange d'abnégation et de foi, dans le culte fantastique de ce rien, de ce lambeau de mélodie, de cette brève et puérile invention harmonique d'une mesure et demie... quelque chose de pervers dans l'avidité sans bornes avec laquelle elle était savourée et exploitée, et on ne savait quel désespoir cynique, une volonté de jouir et de mourir, dans cette façon avide d'en extraire jusqu'à la dernière goutte, de l'épuiser jusqu'à la lie, jusqu'au dégoût et à la satiété, jusqu'à ce qu'enfin, enfin, dans la lassitude succédant à tant d'excès, un long et doux arpège en mineur ruisselât, montât d'un ton, se résolût en majeur et mourut avec une mélancolique hésitation.
« J'ai vu le commencement et la fin » dit Disley dans Le Bruit et la Fureur. C'est bien le sentiment qui m'envahit lorsque je referme douloureusement le livre, non sans avoir versé quelques larmes, pour Tonie, Thomas, et pour Hanno, surtout.