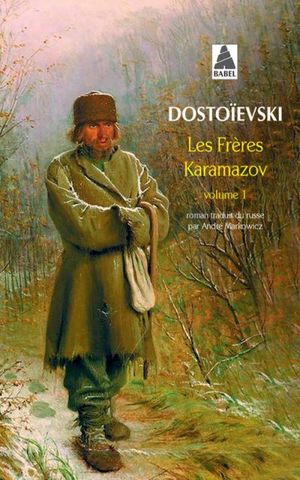Il est difficile de résumer avec des mots l’essence des Frères Karamazov, de catégoriser nettement l’expérience qu’il donne à vivre au lecteur au long de ses 1200 pages qui semblent s’éparpiller dans tous les sens. Et pourtant en refermant le livre, on y repense avec clarté, et sans douter un instant d’avoir absorbé tout ce que Dostoïevski voulait transmettre, en une seule expérience intense, complète et cohérente.
C’est en effet un livre très riche dont il est difficile de saisir l’ampleur. Mais au milieu de cette myriade de thématiques, de dilemmes moraux, de réflexions philosophiques, un thème se démarque en étant omniprésent, à l’origine de chaque situation développée dans le livre : la lutte intérieure entre le vice et la vertu, à laquelle se livre chaque être humain jeté dans le monde, et qui tourmente tour à tour tous les personnages du livre. Cette question revient obsessivement dans l’écriture de Dostoeivski, et c’est d’elle que découlent les innombrables thématiques abordées ici : l’existence de Dieu, la place de la religion, le pardon, la condition humaine, la luxure, l’orgueil, la justice et bien d’autres.
On peut relire chaque passage des Frères Karamazov, ou bien repenser à tel personnage ou telle situation, et ouvrir son esprit à des aspects inédits de l'œuvre, tant celle-ci paraît inépuisable.
Pour encapsuler toute cette profondeur, l’histoire prend une forme intéressante : celle d’un roman philosophique n’ayant pas peur de mettre de côté sa vraisemblance en parsemant son intrigue de moments de réflexion pure, où l’un ou l’autre personnage s’épanche en tirades développant une réflexion ayant pour point de départ sa situation dans l’intrigue. Il n’est pas rare que l'histoire soit véritablement mise en pause dans ce but (notons par exemple le très marquant chapitre du Grand Inquisiteur, fable philosophique complète posée au milieu d’un dialogue entre deux personnages).
De ce fait, l’histoire peut parfois prendre des airs de quête initiatique pour le héros, Aliocha, personnage foncièrement bon, qui va se balader pendant une bonne partie du livre d’un interlocuteur tourmenté à un autre. C’est l’image du moine pur qui quitte son monastère protecteur et entre au contact du vice, des intrigues bassement matérielles, des remous du monde et qui observe tout ce marasme avec hauteur, mais surtout avec empathie. Car Aliocha, dans son rôle d’ange modèle, évite l’écueil d’être un personnage moralisateur. Mis face au péché de l’autre, dont lui-même est exempt, il se contente souvent de compatir affectueusement avec la douleur sous-jacente au péché, ce qui en fait un personnage extrêmement attachant et qu’on se plaît à suivre.
Bien sûr le développement du personnage d’Aliocha n’en est pas pour autant monotone, car il connaît lui aussi des fulgurances d’écriture typique de l’auteur, notamment lorsque cet idéal de vertu, submergé par l’intense négativité des évènements qui l’entoure, s’apprête à se briser. Cet épisode mène alors à l’un des nombreux passages bouleversants du roman où, visité par une vision mystique de l’épisode biblique des noces de Cana, il trouve la force d’aimer inconditionnellement la vie et les hommes et, signe ultime d’humilité et de ferveur, se jette au sol secoué de sanglots, sous l’impulsion d’une maxime énoncée plus tôt :
Arrose la terre des larmes de ta joie, et aime ces larmes.
Ce chapitre illustre bien le genre de texte éclatant d’optimisme sur la nature humaine que Dostoievski est capable de produire, au milieu d’une œuvre autrement pénétrée des pires travers de l’homme : débauche, jalousie, hypocrisie, orgueil… et on retrouve bien dans cette ambivalence notre thématique centrale : ce déchirement constant entre “les deux abîmes”, celui du vice et celui de la vertue.
Le livre ne se cantonne cependant pas à ces dissertations abstraites, bien au contraire, car la plus grande partie du texte s’attache surtout au développement d’une intrigue, et à la description très (parfois trop ?) détaillée du cheminement psychologique d’un florilège de personnages, principaux comme secondaires. La publication originale sous forme de feuilleton semble alors appropriée car pris sous cet angle, le livre forme un petit univers miniature où le destin de plusieurs individus se croisent, s’entremêlent, et chaque acte semble palpable puisque ses conséquences se feront sentir sur le sort d’un autre personnage, au chapitre suivant. Or ce microcosme est un terreau fertile pour générer des situations qui illustrent concrètement les grands questionnements abstraits mentionnés plus tôt. C’est ainsi que chaque aspect du livre résonne avec un autre, et que cette impression de lire une œuvre vaste et complète se forme. On se plaît alors à décrypter, à travers le prisme des réflexions philosophiques abordées, le comportement de tel personnage, et à extrapoler sur les zones d’ombres de sa psychologie que l’auteur semble laisser à dessein, un peu partout. On devine, par exemple, la raison pour laquelle Ivan ne peut souffrir la présence de Smerdiakov, et s’irrite constamment face à lui : il voit en Smerdiakov, insolent et aigri, l’aboutissement logique de sa propre vision cynique de la vie, et cela le trouble au point de rejeter avec une véhémence extrême toute comparaison entre lui même et Smerdiakov.
Une conséquence heureuse de ce focus sur la psychologie des personnages est que, une fois combiné avec le talent de dialoguiste de Dostoïevski, Les Frères Karamazov s’avère être un livre fort en émotions : on ne fait pas que réfléchir sur des sujets intéressants, on ressent surtout avec les tripes les déchirements moraux mis en scène. Les personnages ont une forte tendance à épancher leurs émotions avec une violence grandiloquente que le Romantisme n’aurait pas reniée, et qui personnellement me transperce le cœur. Beaucoup de fébrilité dans les paroles de ces personnages, mais également dans la description de leur attitude et gestuelle : crise de nerf, tremblements, frisson de dégoût et d’effroi, regards méprisants ou à l’inverse larmes de tendresse, apitoiement et expression de pure ferveur. Il faut également voir avec quelle intensité l’auteur décrit la folie et la fièvre destructrice. Ces procédés sont fortement convoqués dans certains passages où le narrateur se détache du style très distant et factuel qu’il revêt souvent lorsqu’il s’agit de disserter sur la société ou de décrire le microcosme mentionné plus haut, et qui a probablement valu à Dostoïevski son association au Réalisme. Parmi les passages où l’individualité et l'émotion priment sur le factuel, je me dois de mentionner une longue section particulièrement poignante de l’histoire.
Il s’agit de l’escapade nocturne de Mitia lorsque, désespéré et au bord du gouffre, il choisi de s’autodétruire dans une dernière nuit d’ivresse et de jouissance, passage onirique dont la puissance émotionnelle culmine lors de ses retrouvailles avec Grouchenka. Faisant suite à une mésaventure des plus kafkaïenne où le personnage lutte pour se sortir de la débauche, mais où tout semble jouer contre lui, cet abandon total et destructeur aux plaisirs des sens puis à son amour pour Grouchenka happe le lecteur. On est laissé aussi lessivé que le personnage lorsque l’ivresse prend fin et que, soudainement, la réalité impitoyable le rattrape.
Enfin, en plus de tout cela, n’oublions pas que le livre présente aussi une affaire policière. Sur cet aspect, il ne faut pas s’attendre ici à l’ambition d’une Agatha Christie : cette intrigue policière sert essentiellement de prétexte à tout ce que j’ai évoqué précédemment. C’est cependant elle qui porte le fil rouge de l’histoire, et elle s’avère parfois prenante, et tout à fait capable de présenter des retournements de situations sympathiques. Quant au procès qui la conclut, il s’agit d’un des moments forts du livre. Certains passages de ce procès auraient selon moi gagné à être écourtés (le réquisitoire du procureur) mais d’autres sont extrêmement marquants, notamment la plaidoirie finale de l’avocat qui est écrite d’une façon très éloquente et avec une grande compétence dans la rhétorique. Cette plaidoirie, véritable bouquet final, boucle de façon très satisfaisante à la fois l’intrigue policière et les thématiques, remettant notamment un coup de projecteur sur le parricide en tant que concept, pas tant mis en avant jusqu’ici malgré sa place centrale dans l’intrigue en tant qu’acte.
En définitive, un livre très marquant, avec lequel je découvre Dostoievski, et je suis convaincu de me jeter un jour sur Crime et châtiment. Mais dans un petit moment, quand la force me sera revenue de mémoriser des dizaines de noms russes à rallonge, et leur surnom associé. Que celui qui a compris sans se référer à la table des personnages que “Mikhaïl Ossipovitch” était Rakitine me jette la première pierre. Ou plutôt, qu’il soit indulgent et me pardonne, s’il a su tirer une leçon des Frères Karamazov.