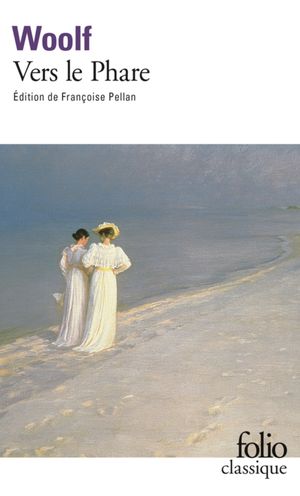Livre absolument remarquable, To the Lighthouse ne se donne pas facilement (à l'image d'ailleurs du phare, objet du désir enfantin qui donne son titre à l'ouvrage). Cette difficulté d'approche est liée aux traits expérimentaux de la narration — lesquels font, in fine, toute la force du projet artistique que présente V. Woolf.
D'abord, To the Lighthouse ne présente pas véritablement d'intrigue ; la narration refuse la continuité que cela impliquerait, et privilégie plutôt le papillonnement d'instants disjoints. Ce choix est d'abord manifeste dans la structure d'ensemble du livre, à peu près tertiaire : une première partie, la plus longue, "raconte" une journée ; la dernière fait la même chose, des années plus tard ; la seconde, enfin, fait figure de cheville (bien qu'elle soit tout sauf gratuite) et unit ces deux moments. Mais surtout, dans le rythme même de la narration, les changements de point de vue sont incessants ; V. Woolf agence ces sauts avec un sens de la transition quasi-cinématographique.
Ils lui permettent de balayer, parfois avec ironie, et non sans une certaine tendresse, les difficultés du langage et de la communication entre les hommes. C'est probablement le thème le plus frappant du roman, avec lequel V. Woolf suscite l'émotion la plus intense ; la scène, on ne peut banale en apparence, durant laquelle Lily considère Mr Ramsey avec une intense compassion, qu'elle est absolument incapable d'exprimer, est poignante.
Mais cette capacité que montre V. Woolf à transformer un récit banal en une intense expérience esthétique n'est évidemment pas due qu'à un parti pris narratif. Tout au long du livre, elle tisse un style remarquable, par moments sophistiqué et ciselé, à d'autres endroits d'un lyrisme dépouillé. Surtout, ce style suit pas à pas, avec beaucoup de souplesse, la pensée des personnages, dans une grande démonstration de steam of consciousness. L'auteur capture les atermoiements de la pensée, les brusques émotions, les sursauts incohérents, avec un remarquable doigté. Il évoque à certains égards celui de Proust, mais pour mieux s'en distinguer ; la pensée proustienne est une pensée “enfin découverte et éclaircie”, tandis que celle des personnages de To the Lighthouse est vivante, prise sur le vif.
(ou du moins, mais c'est un aparte, elle semble l'être : il est intéressant que l'absence d'intrigue mène V. Woolf, contrairement à d'autres post-modernes, à ressusciter l'illusion romanesque : il ne s'agit pas seulement de peindre l'intrigue aux couleurs de la réalité, mais encore de restituer dans son grain les petites inflexions de la pensée. Il va de soi que cette pensée “brute” est en fait infiniment travaillée…)
Il y aurait encore à dire, notamment sur l'art dans To the Lighthouse (qui appellerait un nouveau parallèle proustien) ; on se bornera, pour ne pas user un éventuel lecteur, à saluer une dernière fois ce beau roman sur les difficultés d'être humain.