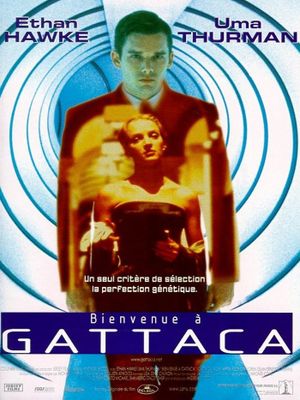S’il y a bien une tâche difficile pour les réalisateurs de films de science-fiction, c’est de représenter à l’écran un futur crédible. Et de fait, combien de films risibles parce que l’avenir qu’ils dépeignent est dépassé, parce qu’il apparaît comme la projection de son époque de conception ?
Et bien je pense que la stratégie de « Bienvenu à Gattaca » pour ne pas tomber dans ce travers est intéressante, maligne, certes, mais pas vraiment satisfaisante. Il ne s’agit pas d’ailleurs à proprement parler d’une stratégie mais plutôt je dirai… d’un refus d’obstacle… Et en effet, à mon sens la forte tonalité minimaliste du film s’explique ainsi : en montrer le moins possible. En montrer le moins possible pour ne pas être pris en défaut. D’où le vide des décors, les appartements trop bien rangés, les villes ressemblant à des campus le week-end, costumes impersonnels etc… Je ne crois pas qu’il y ait une réelle conviction esthétique à l’origine de ces choix, je les crois plutôt motivés par un excès de prudence. En somme, « Bienvenue à Gattaca » a la même tactique que son personnage central qui fait tout disparaître, jusqu’au moindre de ses poils, pour ne pas être pris en défaut, pour durer. En somme, il triche.
Deuxième artifice, original et plus intéressant cette fois : quand la fuite est impossible, quand il y a nécessité de montrer un objet, une voiture, une architecture, le film ne le crée pas, il va le chercher dans le passé. Voitures des années 60, architecture de Franck loyd Wright, peintures du XVII siècle, claviers informatiques des années 90 etc… Je pense que ce choix est là aussi dicté par la nécessité de protéger le film du vieillissement, la moisson d’objets étant caractérisée par une épuration, un classicisme qui lorgnent vers l’intemporalité. Au final, l’avenir proche de « Bienvenu à Gattaca » n’est pas tant une époque caractérisée qu’une tentative de s’extraire du temps, une sorte de best of du passé. Curieux et amusant paradoxe…