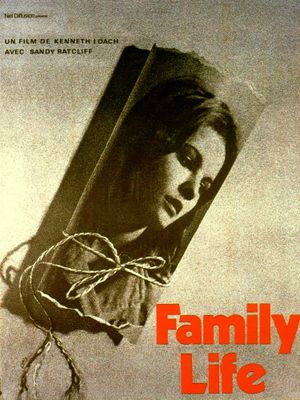La banlieue londonienne, ses pavillons identiques avec leurs jardinets soigneusement entretenus aux pelouses d’un vert inaltérable. Une famille banale parmi les autres, des disputes comme il y a tant. Et dans ce ronron d’une vie morne, désespérément régulière et déjà bien labourée par le Free Cinema, un premier grincement. "Quelque chose ne tourne pas rond", dit le père. Voilà Janice dans un cabinet de consultation psychiatrique. Que s’est-il passé, quel est le sens de ce dérèglement ? Une tentative de compréhension s’ébauche quand soudain tout s’arrête : elle risquait de remettre trop de choses en question, de ces problèmes qu’on a justement l’habitude de tenir pour définitivement réglés. Désormais Janice "est" malade, et ce qui jusque-là se présentait comme une praxis (possédant donc un sens qui demande à être articulé) va devenir un processus (avec tout ce que le terme contient d’inéluctable) qu’il va falloir casser. À sa difficulté de proférer une parole qu’elle pourrait reconnaître comme sienne, parents et psychiatres vont suppléer en lui apportant un secours douteux qu’elle ne peut refuser dans la fragilité de sa situation : parler à sa place. À travers ce lent glissement qui ramène le visage du fou à l’examen de la société contemporaine, semblable en cela à la tache de Lady Macbeth, Family Life porte le témoignage de l’effort mené dans les années 60-70 et identifié sous le nom d’anti-psychiatrie (un courant représenté, sur le plan des sciences humaines, par des philosophes comme Michel Foucault ou Gilles Deleuze). Mais trop de sujets importants y sont abordés, avec la même intelligence, pour qu’on le réduise à un cri contre cette médecine punitive dont on a découvert les méfaits en France lors de l’affaire Gabrielle Russier. Le film remet en cause toutes les structures d’un tissu social cimenté par la religion du travail, crispé dans son respect plus ou moins hypocrite des dogmes puritains, incapable d’offrir à sa jeunesse les perspectives d’avenir qui répondraient aux nécessités. Il commence tout doux et s’empare de nous jusqu’à son terme, nous laissant pleins de doutes sur les vertus de la thérapeutique des malades mentaux. Conclusion : si chacun sécrète son grain de folie, il importe de ne surtout pas le soigner.
https://www.zupimages.net/up/23/28/z8tt.jpg
En suivant à pas feutrés la descente aux enfers d’une jeune femme frappée d’autisme total et victime d’un biotope cauteleusement aliénant, Ken Loach ne cherche nullement à apitoyer le spectateur. Pas une seule fois non plus il ne brandit la carte de la démagogie facile. Il se garde bien de jouer les trublions de l’orthodoxie à la manière des aboyeurs professionnels dont la profession rémunératrice est justement l’anticonformisme ; il ne s’aventure pas davantage dans les sables mouvants du pamphlet. Chez lui la technique du coup de poing s’efface au profit d’un minutieux travail de sape. Il oppose un brillant et cinglant démenti à ceux qui pensent que la méthode du clou dans la tête doit passer par l’outrance ou l’hénaurme. Rien de plus réaliste que Family Life. Rien de plus poignant non plus, car la lucidité critique du cinéaste y est toujours en alerte. Son honnêteté intellectuelle l’incite à vouloir tout comprendre, même les personnages représentant ce qu’il combat et qui cependant ne sont pas des caricatures. Jamais pris en défaut, son tact s’affirme jusque dans les scènes les plus difficiles : Janice dessinant un bébé sur son ventre pour fixer ce qu’on va lui arracher ; l’orageux repas dominical où une personne extérieure, aux jugements clairs, tente de l’extirper à sa condition et fait éclater le conflit. La rigueur de l’analyse, l’audace de l’assaut social (et politique) sous les dehors d’une quelconque étude psychologique, la netteté de la prise de prise de position ne sauraient masquer l’essentiel : ce tour de force qui consiste à faire presque oublier le but de l’œuvre, l’attitude morale qui la parcourt en épousant une remarquable nudité stylistique. Après Kes, qui montrait comment l’école et l’éducation rognaient les rêves de l’enfance, on avait justement comparé le cinéaste anglais au Truffaut des 400 Coups. Mais devant ce troisième long-métrage, il devenait évident que Loach était trop grand pour tout modèle et qu’il asseyait définitivement sa place cruciale au sein du cinéma britannique.
Au-delà des apparences, la question posée par le film reste celle-ci : qu’est-ce qui rend schizo ? La famille ? Le propos reste là-dessus non pas ambigu, mais volontairement sans réponse. Car les parents de Janice, eux-mêmes victimes de la "machine sociale", ont été produits comme tels et se retrouvent devant une espèce de débâcle où ils ne peuvent subsister qu’à travers une violence qui les dépasse et dont ils sont les agents actifs et impuissants à la fois. En ce sens, la famille intervient comme un relais privilégié dans un système plus vaste qui fabrique ses fous avec autant de précision que ses montres. Mais dès qu’ils sont là, dès que l’héroïne tangue et appelle à l’aide à sa façon, le monde lui aussi vacille et plante impitoyablement ses barrières. C’est le perspicace docteur Donaldson qui va servir de révélateur, en suscitant trois discours. Celui de Janice, hésitante, incapable d’opposer une autre pensée à celle qui l’opprime, laisse percevoir la réalité de sa vie quotidienne : des emplois ingrats qui l’asservissent sans la délivrer de la dépendance de ses parents, porte-paroles vigilants de l’idéologie majoritaire. Celui de la mère, carapaçonnée dans sa dignité, son conservatisme et ses bons sentiments, qui a forgé sa fille à son image, en a fait une sorte d’appendice d’elle-même qui la reflète complaisamment et justifie ses convictions. Celui du père, éternel exploité qui s’accroche à une autorité dérisoire, de pure façade, et dont la seule manifestation possible est de maintenir ses enfants dans l’état de soumission auquel il est lui-même assujetti. Ce couple gardien des convenances et des valeurs traditionnelles incarne une faillite exemplaire : uniquement soutenu par le devoir d’élever sa progéniture selon les règles, il ne peut envisager de se trouver en face d’un être autonome, adulte, dont le départ saperait les fondements de son existence. Plus la jeune fille résiste, avec les faibles moyens dont elle dispose, à la domination de la vie familiale, plus celle-ci accroît sa répression. Jusqu’à cette séquence terrible, ce crescendo de tension nerveuse où, devant Janice muette, sa sœur aînée (ayant fondé son propre foyer) et ses parents s’accrochent cruellement autour d’un enjeu qui n’est autre qu’elle-même : une chose que l’on se dispute.
https://www.zupimages.net/up/23/28/zdfu.jpg
Par son sujet polémique, son approche contestataire, sa puissance réquisitoriale, sa virulente mise en accusation d’une société coercitive, Family Life anticipe en quelque sorte Vol au-dessus d’un Nid de Coucou. Il dénonce les inhibitions, les tabous et les servitudes de la cellule familiale autant que les pernicieux procédés de l’hôpital psychiatrique, son rôle d’oblitération et son (dys)fonctionnement. Il s’inspire des théories de R.D. Laing pour qui l’environnement bien plus que les composantes psychiques d’un individu est cause de sa maladie mentale. Vulnérable, chancelante, mal protégée, Janice est détruite par ceux-là même qui devraient concourir à sa guérison. D’électrochocs en tranquillisants, l’appareil médical se lie à la famille avec la bénédiction des lois pour la rendre inoffensive, docile, adaptée à l’ordre établi : assassinat licite, parfaitement courant, exécuté au nom du vieux mythe disciplinaire. C’est un peu le monde terne du travail organisé qui se défend contre une jeunesse qui lui échappe : lors d’un accès de révolte, la jeune fille brise l’horloge-trophée de son père, esclave de l’horaire. Donaldson fait remarquer à la mère : "Tant qu’elle est d’accord avec vous, vous la trouvez normale." Dans ce portrait de femme abusive, refoulée, éprise de marques de respect et réclamant l’obéissance comme règlement d’une dette permanente (avoir reçu la vie), s’incarne une catégorie désorientée qui se sent révolue et profite de son éphémère pouvoir légal pour étouffer ses enfants. Si Janice est malade, c’est d’un simple délit d’opinion. On l’enferme sur dénonciation de différence, comme au temps de la lettre de cachet. Le film trace implacablement, atrocement, l’aggravation de sa névrose : son incapacité à couper les liens avec sa famille comme l’a fait sa sœur, la perte progressive du respect d’elle-même, le regret d’un avortement non désiré, les rapports avec son amant sans cesse soumis à la censure morale de sa mère, les violentes querelles qui déclenchent l’internement.
Tenant d’un naturalisme lyrique d’une très grande force descriptive, Loach lance un authentique et salutaire cri d’alarme et de raison. Perturbant, irréfutable, son film a la fascination des crimes parfaits. Rien ne s’y formule, rien n’y est représenté qui n’ait été vrai au moment où il a été conçu. Devant l’évolution d’un état morbide que les soins ne cessent d’accélérer, devant la seule pensée que l’on puisse faire fausse route à propos de pareilles épreuves, l’indignation déborde et l’émotion submerge. En guise de remède, la bonne conscience bourgeoise propose les barreaux des asiles d’aliénés à ceux qu’elle ne peut jeter au fond des geôles. Son petit ami Tim, élève aux Beaux-Arts, est peut-être le premier à entrevoir le piège qui se referme sur Janice. Sa culture et sa position lui permettent de se tenir quelque peu en retrait de cette société qu’il conspue, sans penser à la transformer, et qui le tolère dans la mesure où son insubordination s’exprime dans la peinture et le canular. Il incite la jeune fille à quitter sa famille sans se rendre compte qu’elle n’a pas les moyens de s’y décider, et sans pouvoir l’aider à les y acquérir. L’emprise de ses parents est plus forte que l’aspiration à une liberté qu’elle n’a jamais pu concevoir. Le dernier effort de Tim sera de l’enlever de l’hôpital, mais c’est alors une somnambule réduite au silence qu’il entraîne derrière lui. Si Janice est inapte à la société, elle servira la science. La psychiatrie est résolument aveugle aux racines de la pathologie dont la mise à jour mettrait les institutions devant ses contradictions. Le malade sert de légitimation au discours de la norme triomphante, qui inventorie les symptômes et apprend à envisager leur développement sans chercher à se donner les moyens d’intervenir autrement que par la régression. Aboutissement logique, Janice finira offerte, tel un chimpanzé derrière sa cage, à la curiosité des étudiants. Et maintenant, demande le professeur après avoir présenté son naufrage comme un cas clinique : "Pas de questions ?"
https://www.zupimages.net/up/23/28/1e0e.jpg