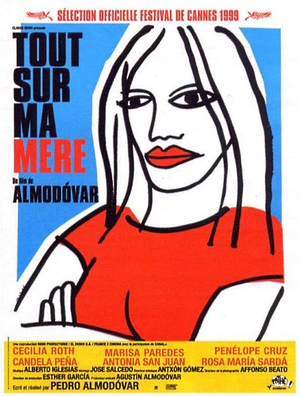Alors comme ça, Pedro Almodóvar nous dirait tout sur sa mère ? Ce titre n’est peut-être pas un mensonge, mais à coup sûr un trompe-l’œil. Car le peu que cet excellent fils ait jamais raconté sur celle qui le mit au monde, il faut plutôt aller le chercher du côté de La Fleur de mon Secret ou de Volver. La confusion est encore obscurcie par l’amalgame qu’il établit volontairement entre mère et actrice. Sans compter que le père présente ici tous les traits extérieurs d’une figure maternelle. Qui parle ? L’enfant qui meurt au début ? Celui qui naît plus tard ? Questions laissées béantes comme autant de plaies dans un film agité, saturé, joyeusement triste et amèrement optimiste, maniant les paradoxes comme s’ils étaient la politesse du mal de vivre. Le générique s’inscrit en grandes lettres, flottantes puis stabilisées, sur les images d’une poche de perfusion, de matériel médical sophistiqué, jusqu’aux lignes horizontales et parallèles d’un encéphalogramme plat. Un homme est cliniquement mort. De lui on ne saura rien, sinon qu’une procédure est engagée dans l’urgence pour prélever sur son corps des organes susceptibles d’être greffés à des vivants en attente. L’histoire démarre ainsi sous le triple signe de la modernité, de la mort et de la vie. Coordinatrice des transplantations dans un hôpital madrilène, Manuela incarne, lors de séminaires de psychologie, la proche éplorée apprenant de la bouche des médecins qu’un membre de sa famille est décédé. Cette fois, elle éprouve la scène pour de bon. Plus qu’un coup de force scénaristique, c’est une sorte de manifeste almodóvarien : en chaque femme repose une actrice appelée à franchir, dans un sens ou dans l’autre, la frontière entre jeu et vérité. Le point nodal de l’intrigue est donc simplement tragique : une mère perd son fils dans un accident. Sur cette situation initiale, les Grecs concoctaient des drames déchirés et Hollywood du tear-jerker pur beurre, pétri de dignité plus ou moins frelatée. Pas vraiment le genre de la maison. Almodóvar est un cinéaste de la limite. Mais c'est dans la réalité même qu'il pose la question de la rampe, cette ligne symbolique séparant la scène de la salle, le théâtre de la vie, l’un étant le reflet, la métaphore, le contre-champ de l’autre. Ode baroque à la puissance évocatrice des mots et à celle plus flamboyante du cinéma, farce burlesque et poignante sur les amitiés indéfectibles, munificent bariolage de couleurs, de liberté de ton et de mélange des genres, Tout sur ma Mère est surtout un torrent d’amour fou, une chorale cyclonique des sentiments qui courent, fulgurent et se manifestent à fleur de peau.
https://www.zupimages.net/up/21/02/4g6c.jpg
Galvanisée par son malheur, Manuela quitte Madrid pour Barcelone afin de retrouver le père d’Esteban, qu’elle lui a toujours caché. Elle entame un chemin aventureux et picaresque, scandé par des titres signalant la fuite du temps (le récit s’étend sur deux ans et demi). Son périple l’amène à retrouver les fantômes de son passé et à croiser des trajectoires nouvelles. Elle qui s’était isolée de la marche du monde, la voici qui renoue avec une existence de bohème, replonge dans les décombres de la misère, de la détresse et de la marginalité. Improvisant pour chacune le sourire qui redonne courage, elle arrache Agrado à la pouillerie de la prostitution, aide Huma, grande comédienne en plein fatras conjugal, à poursuivre un spectacle menacé par la toxicomanie de sa compagne, insuffle à une bonne sœur enceinte (et pas par l’opération du Saint-Esprit) la volonté de donner naissance à un bébé séropositif, puis prend en charge cet enfant quand la mère meurt. Lui aussi sera baptisé Esteban, prénom qui participe de l’existence de chacun et de la continuité de tous, puisqu’il est attribué à trois générations successives. Traité aux anticorps, il éliminera le virus du sida planant comme une ombre funeste sur toute la fiction — triomphe de l’espoir. D’autres "miracles" surviendront dans cette tragicomédie qui tournerait à la fable édifiante si elle n’était marquée par une verve, une insolence, un humour, une lucidité qui emportent tout. Figure d’altruisme et de bienveillance, ravaudeuse de force vitale, repriseuse de ce qui se défait, Manuela se rend totalement disponible en endossant tour à tour les fonctions d’infirmière, de cuisinière, de secrétaire, de nounou, d’intendante, de doublure. Mais loin de le sanctifier, l’auteur suggère que son insatiable dévouement est d’abord un instinct de survie, une manière intuitive de se consoler de la douleur, d’accomplir son travail de deuil. Elle transfuse aux autres une confiance indéracinable dans la vie, tout comme le cinéaste bouture sa sensibilité sur des histoires tordues et des êtres aussi déjantés que les saints et les martyrs. Putes transsexuelles jouant les duègnes, pères travelos, madones allumées, nonnes filles-mères, actrices lesbiennes et junkies… Chez Almodóvar, pour qui tout ce qui est humain se doit d’être respecté, voire admiré, ces improbables héroïnes trouvent leur densité de chair et d’âme, magnifiées par des comédiennes dignes de comparaître à l'ordre du mérite cinématographique : Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña, Penelope Cruz, Antonia San Juan... Elles aiment, mentent, prient, se battent, maternent et pleurent. Des larmes retenues, des sanglots étouffés, provoqués par des destins que malmènent le hasard et qui suscitent la plus vive compassion.
La structure adoptée par Tout sur ma Mère cultive le motif obsédant de la répétition, de l’éternel retour : un premier acte très bref, purement dramatique, un second très long, truffé de strates et de méandres, un troisième aussi court, où la boucle se referme symétriquement avec une nouvelle maternité, un nouvel enfant, une réconciliation. Rien ne meurt complètement, tout se transmet. Ce n’est pas un hasard si le cinéaste consacre une séquence entière, tel un impérieux décrochage, au parcours du cœur du jeune défunt, depuis son extraction jusqu’à la sortie d’hôpital du patient transplanté. Pas un hasard non plus si tous les messages parviennent tôt ou tard à leurs destinataires. Huma finit par rédiger l’autographe que lui réclamait Esteban et qui lui coûta la vie. Le journal intime que tenait le garçon, comme autant de paroles adressées à son père absent, finira par être remis à celui-ci. Rien ne reste lettre morte, tout fait lien. Hymne à la bonté, à l’entraide, à la solidarité, le film dispatche ses éléments narratifs et sa galerie d’énergumènes excités(e)s sur la grande carte de la tendresse universelle. C’est-à-dire en plein cœur. Sa façon de se déployer dans le temps et l’espace, de relier les solitudes à travers les générations, de mêler les vivants et les morts, sont pour le cinéaste autant de signes d’une maturité qui s’offre de véritables audaces. En témoigne cette séquence fulgurante, d’un kitsch superbe, où Manuela arrive à Barcelone. Un tunnel interminable, et soudain le ciel au-dessus de la ville illuminée, la voix chaude d’Ismael Lô, quelques clichés nocturnes de la cité interlope, un soupçon de Movida, pour un émerveillement intact : clair-obscur, noria d’automobiles michetonneuses autour de créatures aux appas aérodynamiques sculptés dans la silicone, léchées par la lumière fantomatique des braseros. Après Fellini-Roma, voici Almodóvar-Barcelona. En apparence, tous les ingrédients de son univers sont là. Mais il ne faut pas se fier au papier peint furieusement 70’s de l’appartement dans lequel s’installe Manuela : il n’est qu’un lieu de passage, transitoire comme tous ceux dont elle va, un moment, partager l’existence. C’est ce sentiment aigu de l’éphémère qui rend le film poignant. Car avec son cortège d’illusions et de pièges mortels, Tout sur ma Mère est aussi un cimetière, même si on le parcourt en fredonnant.
https://www.zupimages.net/up/21/02/i62x.jpg
Dans sa quête de plénitude, le récit semble vouloir fondre tous les autres déjà racontés. Il embrasse à la fois Un Tramway Nommé Désir, Opening Night (l’accident du fan à la sortie du théâtre), Europe 51 (la mort du fils qui entraîne la quête d’Ingrid Bergman), Femmes de Cukor (le méli-mélo intégralement féminin), le mythe d’Œdipe (le père aveugle errant dans la rue un bâton à la main)… Et surtout Ève, qu’Almodóvar semble considérer comme un modèle indépassable mais dont, peut-être pour cette raison, il subvertit totalement le sens. L’héroïne-titre de Mankiewicz était un monstre d’arrivisme et d’égoïsme, vidant de sa substance la star qu’elle faisait mine de servir. Rien de plus étranger à Tout sur ma Mère que les notions de vol et de propriété. Rien n’est exclusif à personne et surtout pas l’énergie créatrice, faite pour être partagée. Le texte de Tennessee Williams circule donc librement, plusieurs plans montrant Manuela puis Agrado le réciter à mi-voix pendant que Nina le dit sur scène. L’imitation n’est pas un déficit de créativité mais un temps d’éveil et de construction. À l’époque où il faisait figure de pionnier, le réalisateur semblait jouer avec l’idée qu’on pouvait rudoyer les corps, changer de sexe comme de chemise. Ici c’est une force archaïque, tellurique, qui permet à certains êtres humains de transgresser la Loi biologique. En une seule scène renversante (l’apparition de Lola), il redonne au transsexuel son essence divine, celle de l’androgyne primitif, homme et femme à la fois. Mais tout le monde ne peut pas prétendre à l’Olympe. À côté de Lola, ange de la mort, il y a la truculente Agrado, qui a choisi le patio, la maison des femmes, la cour des songes et des mensonges. C’est à elle que revient le privilège de prendre en charge le discours de l’auteur au sein de la narration. Improvisant sur scène un monologue impromptu, elle énumère les multiples opérations qui ont fait d’elle ce qu’elle voulait être. Almodóvar parvient lui aussi à ce point de coalescence où l’artifice se défait de sa relation d’opposition au naturel pour atteindre son propre régime de réalité. Il ne rajoute pas seulement des couches de vernis à des formes préexistantes exhibées comme de simples contenants, mais vise à retrouver le mouvement interne qui les a animées, leur matière plutôt que leur surface. Sa culture intense et personnelle ouverte à toutes les marges, son romanesque luxuriant qui s’invente dans une nécessité radicalement contemporaine, donnent corps à une grande œuvre émouvante, généreuse et vivante. "Une femme est authentique lorsqu’elle ressemble à l’image qu’elle a rêvée d’elle-même", explique Agrado. Ce qui vaut pour une femme ne vaudrait-il pas aussi pour le cinéaste ? Ce film-là, on en est sûr, ressemble à celui qu’Almodóvar a rêvé.
https://www.zupimages.net/up/21/02/k0r4.jpg