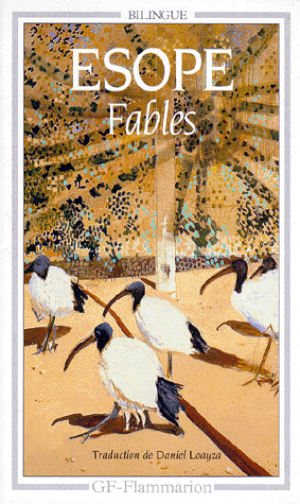Les plus anciennes fables de l'Occident.
Le genre de la fable, relativement peu prolifique dans la littérature occidentale, est réputé avoir pour fondateur le Grec Esope. Son existence même est discutée, et ceux qui la valident lui assignent l'époque archaïque de l'histoire de la Grèce (VIIe - VIe siècles avant Jésus-Christ) comme cadre chronologique vraisemblable.
Bien entendu, il ne faut guère en espérer davantage qui soit plausible. Esope aurait été originaire de la ville thrace de Mésembrie; il fut affranchi par Idmon après avoir été l'esclave de Xanthos; il se fit une certaine réputation auprès des Samiens en leur racontant une fable; il aurait été mis à mort injustement par les Delphiens.
Tout cela est un peu court pour deviner pourquoi ces 273 textes lui sont attribués. Encore ne s'agit-il pas là d'un nombre canonique. Ces textes nous sont pour la plupart parvenus sous plusieurs "recensions", c'est-à-dire des versions légèrement différentes.
Les animaux mis en scène sont communs dans nos régions pour la plupart (Chien, belette, loup, chèvre, grenouille, renard...), ou parfois plus exotiques (lion, chameau, panthère, singe). Le rapport entre l'action décrite et les attributs traditionnels de ces animaux est assez souvent clair (le serpent est traître, le loup est vorace...), mais il arrive parfois que le casting pourrait être bouleversé sans que l'action en soit notablement altérée. Ainsi, dans la fable 171, une chauve-souris, une ronce et une mouette se font banquiers et commerçants. On n'y aurait pas pensé spontanément.
C'est que cette fable tire du côté du mythe étiologique: elle prétend expliquer le comportement habituel des chauve-souris, des ronces et des mouettes par ce qui est arrivé dans cette histoire. On est proche du mythe de fondation.
Des hommes et des dieux sont parfois mis en scène, dont Esope et Zeus eux-mêmes.
Mais la majorité des fables ne présente pas ce souci explicatif quelque peu archaïque. Sous forme de petits récits très simples, elles cherchent à transmettre une expérience pratique et morale : "La fable nous montre que lorsqu'un point nous touche de près, nous revenons toujours y buter". "Cette fable pourrait s'appliquer à qui n'accorde pas ses actes et ses paroles." "Cette fable enseigne qu'il ne faut pas traiter de même les bons et les méchants."
La narration, ainsi que la moralité, sont en prose, et rédigées en un style minimaliste, ce qui les rend particulièrement propres à être apprises par des générations d'élèves pendant plusieurs siècles. De fait, Esope a été un des grands pédagogues de la Grèce.
On y trouvera les canevas dont La Fontaine a tiré ses chefs-d'oeuvre : le loup et l'agneau, le corbeau et le renard, la mort et le bûcheron, etc. Mais ceux qui s'attendraient à retrouver la splendeur versificatrice baroque du grand fabuliste français en seront pour leurs frais: les récits, pour pittoresques qu'ils soient, sont expédiés avec une grande platitude, et ne cherchent, au mieux, qu'à exposer une vérité générale en termes métaphoriques.
Les fables d'Esope trouvent leur prolongement chez d'autres auteurs anciens : Phèdre, Babrius, Avianus. La présente édition expose fort au long ce que peut bien être une fable en soi, et présente quelques versions alternatives de certains textes.
Le charme prenant de ces textes n'est donc pas d'ordre strictement poétique, mais plutôt anthropologique : les vérités permanentes de l'humanité penchent vers une mise en scène totémique, usant de la métaphore et de la prosopopée, relevant d'une époque où l'homme cherchait à formuler en son langage articulé tout neuf les règles de survie dans son environnement et vis-à-vis de ses semblables. L'identification du lecteur vis-à-vis de certains des acteurs des fables relève aussi bien de la sympathie émotionnelle que d'un sentiment plus trouble : celui de remonter vers des origines animales, plus ou moins féériques : un monde où les bêtes parlent entre elles, d'une espèce à une autre, sans avoir besoin de traducteur.
Esope nous livre les leçons de sagesse élémentaire de toute enfance.