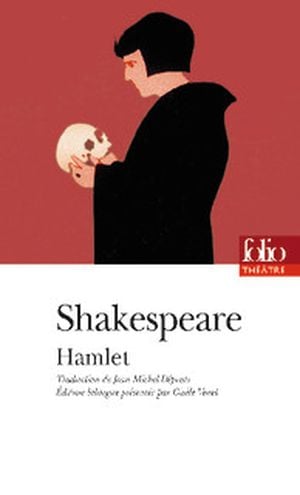Il y a bien longtemps, quand j’étais lycéen, j’ai assisté à la représentation en anglais d’Hamlet, dans la mise en scène de Peter Brook. Je ne connaissais presque rien de la pièce, et ne comprenais rien de ce que disaient les acteurs (mais la pièce était sous-titrée). Pourtant c’est une de mes expériences théâtrales les plus saisissantes, en raison notamment de la beauté de la langue, évidente même pour qui ne la comprend pas.
Bien des années après, j’ai enfin lu cette pièce, avec beaucoup d’intérêt, mais sans l’émerveillement de ma jeunesse. Habitué au théâtre classique français, j’ai aimé la façon dont cette pièce nous confronte à des énigmes qui ne se dissipent pas : qu’est-ce qui fait agir les personnages ? Comment au contraire expliquer l’inaction d’Hamlet ? Leurs paroles sont-elles sincères, ou masques derrière lesquels ils se dissimulent ? Par exemple, le repentir de Claudius est-il sincère ?
Autre exemple, le célèbre « To be or not to be », si galvaudé qu’on a peine à prêter attention à son sens même. Tout d’abord, il n’a rien à voir avec la scène du cimetière ! Cela montre la difficulté d’aborder ces œuvres si célèbres qu’elles disparaissent presque derrière l’image qui en a été forgée. Mais surtout, en lisant la pièce, il est bien difficile de de savoir si cette tirade est le reflet des angoisses métaphysiques d’Hamlet, ou si c’est pour lui un stratagème pour simuler la folie. Cette absence de sens univoque, le faible intérêt de l’intrigue, amènent à s’intéresser davantage à ses méditations existentielles, et font comprendre pour quoi le rôle d’Hamlet est si mythique : plus que beaucoup d’autres, il permet au metteur en scène et à l’acteur d’incarner une vision personnelle du personnage. Pour le spectateur, cela peut être une expérience fascinante ; le lecteur, lui, reste parfois sur sa fin.
Enfin, l’on a tendance à retenir surtout de la pièce ses interrogations métaphysiques. Mais j’ai aussi aimé la satire de la cour et des courtisans, et plus encore le beau poème sur la chute de Troie déclamé par les acteurs à l’acte II.