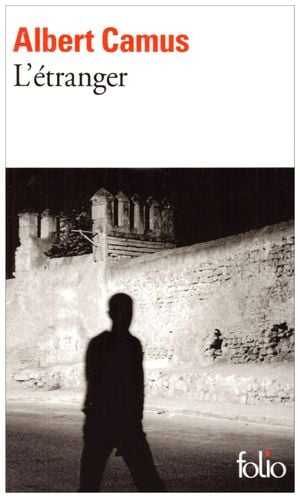On nous présente ce livre comme une œuvre de révolte, une gifle à la face des conventions. Mais quelle révolte ? Je n’y vois qu’un enterrement, et pas seulement celui de la mère du héros. « L’Étranger » est une cérémonie funéraire d’un autre genre : celle d’un homme qui a cessé d’exister avant même que la mort ne l’atteigne.
Meursault n’est pas un insoumis, c’est un spectre. Il ne lutte pas, il ne crée pas, il ne veut pas. Il laisse les événements se poser sur lui comme la poussière sur un meuble oublié. Camus, dans sa grande générosité, lui offre même une exécution, une fin "acceptée", une dernière pose pour lui donner une apparence de grandeur. Mais derrière cette mascarade, il n’y a rien. Rien que le vide, l’inaction sacralisée, la résignation érigée en vertu.
L’époque acclame Meursault parce qu’elle se reconnaît en lui. L’homme moderne, gavé d’opinions sans conséquences, asphyxié par son confort, ne cherche plus la grandeur mais une justification à son propre renoncement. Il voit en Meursault un modèle non pas parce qu’il est libre, mais parce qu’il s’est abandonné avec une indifférence qui flatte sa propre lâcheté.
La littérature, jadis forge des âmes ardentes, se contente maintenant de polir des miroirs pour que chacun puisse s’y contempler sans honte. « L’Étranger » est une grande œuvre, mais elle est grande comme une pierre tombale : massive, imposante, et tristement définitive.