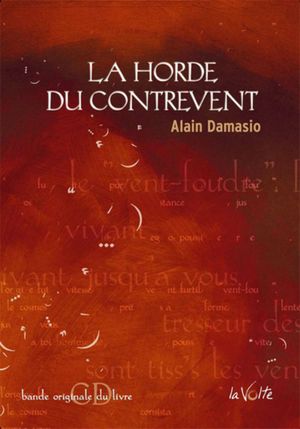Longtemps je me suis demandé à quoi pourrait bien ressembler le roman de l’immanence. Le roman classique avec son narrateur omniscient, extérieur à l’action est le véhicule nécessaire d’une morale. De même, la toute puissance du narrateur proustien sur son univers maintient l’effet d’une verticalité et si La Recherche est l’exposé d’une subjectivité, il s’agit paradoxalement d’une subjectivité transcendantale. Tout roman du « je » ne résout ainsi pas le problème. Ce que réussit Alain Damasio, en faisant raconter son histoire par des narrateurs multiples, sans qu’aucune instance extérieure ne vienne dire l’action et ainsi la juger, c’est créer la fiction de l’immanence. La vérité sur l’action est ainsi reléguée à une précarité qui se situe à la confluence des points de vue tandis qu’une vérité intime ajoure en chacun à mesure qu’il progresse dans sa quête de la neuvième forme. La vérité collective est le point de jonction mobile de vérités individuelles construites à partir de l’expérience sensible. Spinoza est naturellement convoqué et la recherche des formes du vent s’apparente à celle des genres de connaissance du philosophe hollandais. Ici aussi, le domaine réservé généralement à la métaphysique est incorporé à la physique et la connaissance des dernières formes abstraites du vent résultent de celle concrète des premières. La séparation qu’opère la philosophie classique entre l’abstrait et le concret se retrouve caduque et le monde réunit. C’est ainsi que matière et esprit sont tissés dans la nature commune du vent qui tout en étant la contrainte qui engendre le monde, qui engendre tant sa physique étrange que l’imaginaire d’où procède son écriture, en est aussi le principe de vie. Une vie qui devient circulation et métamorphose. On pense à Spinoza mais à travers lui beaucoup à Deleuze. A cette éthique où les choses et les êtres deviennent équivalents, où tout devient « rapport de vitesse et de lenteur ». Qu’on se rappelle par exemple ce passage :
« – Il lui faudra plusieurs semaines pour retrouver une forme de vitesse, tu sais. Pour réinjecter du mouvement dans les cristaux. D’ici là, nous serons loin ! Là, je crois qu’il est tombé à la limite de l’indifférencié : il respire en monolithe. Pourtant son vif bat, un vif si fragile, à peine une turbule, mais qui suffira à tout relancer, par écart croissant, par chaos amplifié. C’est comme une aptitude primitive à se différencier qui le hante, Oroshi, qu’on ne peut pas lui enlever, ni lui combler. C’est sa force. Il se reconstruit toujours, il a la vie en lui !
– Oui […] Il commencera par de ridicules cristaux qu’il va fondre puis regeler. L’eau donnera de l’herbe qu’il fera pousser dans les fissures, l’herbe des arbustes vivaces. Et entre minéral et végétal, il va circuler, s’alimenter, exploiter la puissance de l’écart. Et quand il sera assez diversifié et assez véloce, alors recommencera le corroi… Partout où il passera, la rouille va ronger, le bois moisira, ça se délitera doucement, ça partira en poudre et en poussière parce qu’en toute matière organisée, il absorbera ce qui la tient debout : le vif et le lien, cette tension active des différences. Il nous a tué Karst et toi tu restes agenouillé à le contempler…
– Tu ne trouves pas ça fascinant ?
– Si. Parce qu’en un sens, il est comme toi troubadour : il n’est qu’une autre forme prédatrice de la vie. »
Un personnage se distingue pourtant rapidement, celui que cet extrait a fini de m’attacher :
« J’ai eu brutalement besoin du groupe, de voir nos visage, j’ai cherché Oroshi des yeux, où était Pietro, qui discutait avec les filles – je n’ai retrouvé personne. Je me suis dit qu’à l’évidence, s’aérer de rencontres fraîches et fuir un peu le carcan du Pack devait être vital pour beaucoup d’entre nous, pour Caracole plus qu’aucun autre, alors que pour mon compte, je conservais cette envie de tout partager, ou plutôt de faire ces découvertes ensemble. « Tu n’as jamais envie d’être seul ? » m’a dit Oroshi hier tandis que j’éternisais, c’est vrai, mes « Bonne nuit ». Pas souvent, non : j’ai besoin de cette énergie fluante du groupe, de sentir les tensions et les fusions qui nous traversent, chacun et tous. J’ai besoin de me sentir noué dans la pelote de nos fils. »
Parce que si le récit du groupe détermine nécessairement un récit de la solidarité, cette solidarité doit être vécue et portée, malgré les faillites nécessaires. A défaut d’un héros, le récit doit se doter d’un héraut pour qu’il nous parvienne (immanence, toujours). Il n’est pas anodin que celui qui la porte au plus haut point soit scribe, c’est-à-dire écrivain et on y verra naturellement le reflet de l’auteur, dont un extrait du journal audio utilisé avec sa permission dans le morceau Bora Vocal de Rone permet de bien saisir la problématique (https://www.youtube.com/watch?v=Dzrw52pTpso). L’isolement que réclame Damasio pour lui-même est l’aboutissement de la quête de Sov qui doit aller d’abord contre lui-même pour se retrouver, aller au bout d’une solitude pour retrouver les autres en soi. Il y a bien comme chez Proust le récit d’une vocation et d’un moyen et sourdent alors en moi les mots qui terminent La Recherche, ces mots surprenants qui vous font vous dire lorsque vous refermez le livre de Proust, que finalement, vous n’aviez rien compris et recommencer :
« Aussi, si elle m’était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne manquerai-je pas d’abord d’y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace, une place au contraire prolongée sans mesure puisqu’ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années à des époques, vécues par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer – dans le Temps. »
En vain, on se demande à quoi ressemblerait le monde qui nous est décrit, à se le figurer, or Damasio est un écrivain et comme l’explique Ne Jerkka, « les formes ne sont qu’une enveloppe commode, un bel outil de classification. […] Ce qui importe, ce sont les forces ». L’écriture s’engage du côté des forces quand la peinture ou la sculpture s’occupent des formes. La puissance de Damasio est dans l’acuité transversale de son regard, la plongée en coupe, et dans le mouvement d’une écriture en souffle.
Alors que vous êtes en train de finir La Horde du contrevent, vous tombez sur un passage comme celui-ci :
« J’avais un mal fou à conjurer le bruit blanc produit par les trains d’ondes des lumens et du sonochrone et je n’accédais que par brèves fenêtres à la rythmique de ces vifs pour en scruter les impulsions. »
Et vous vous dites que sans doute, l’écriture c’est cela : aller au bout d’un processus où l’incompréhensible atteint la transparence de l’air.