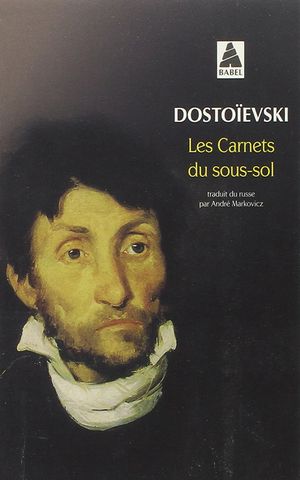Les Carnets du sous sol est un texte charnière, une charnière autour de laquelle grincent les deux pans de l'oeuvre de Dosto. Comme un dernier adieu, un larguage d'amarres : après ça, et jusqu'à l'épuisement total, l'écrivain va construire une cathédrale improbable, impensable, et sans reprendre son souffle: Crime et Chatiment, l'Idiot, Les Démons, l'Adolescent, les Frères Karamazov !
Cri halluciné, hallucinant, ces remugles d'une âme en peine, nouveau journal d'un fou dégueulé à la face d'un monde qui ne peut surement plus être sauvé, agissent sur le lecteur - sur la littérature ? - comme un accélérateur de particules devenu hors de contrôle. Dosto invente le four à micro-onde romanesque : il porte à l'incandescence chaque mot, chaque situation, il affole les molécules de ses phrases jusqu'à la désintégration, plus rien ne tient ensemble, les corps, les discours, les idées implosent, puisque c'est dans la fusion et la déflagration qui s'ensuit que réside, incompréhensible et in-préhensible, la vérité des êtres.
Tout à la fois monologue, confession, témoignage, cette mise au point qui se vautre dans le flou, ce récit d'un aveuglement lucide, d'une honte fièrement étalée, se donne à lire à l'envers : la théorie d'abord, l'exemple ensuite. La table rase d'un esprit égaré (mais on sait combien pour les Russes la vérité est à chercher dans le discours des insensés) qui, ayant tout détruit dans son existence se met à déchirer en charpie son esprit, ultime combustible à jeter dans le feu de la Vie, suivie d'un épisode de sa jeunesse qui le torture, rendu éternellement présent par l'écriture, cette harpie sans pitié. Oui, on dirait que c'est ça que soudain touche du doigt Dosto : le nœud est là ! Un nœud si angoissant, qu'il est tranché en une phrase ("C'était plus fort que lui, il a continué. Mais il nous semble, à nous aussi, que c'est ici que l'on peut s'arrêter") par celui qui nous avait d'abord "offert" à lire ces carnets exemplaires, et qui nous les retire de sous les yeux, comme si la révélation était encore trop neuve à son esprit, et trop cruelle, pour être dévoilée jusqu'au bout : en sauvant notre passé de l'oubli, la littérature nous tue de la pire des façon, elle nous tue éternellement. Le vrai bourreau, impitoyable, c'est elle, qui réactualise à chaque lecture la souffrance des hommes, gravant dans leur chair - comme la machine infernale de Kafka - tout ce qu'ils auraient préféré voir disparaitre dans la nuit de l'amnésie.