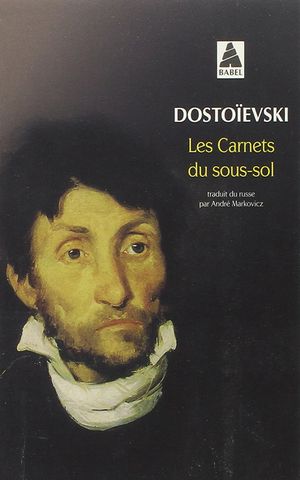Ce livre est l’étalement d’un mal-être sur des dizaines de pages. Même si la lecture n’est pas agréable, c’est un bon livre, car le but de l’auteur est de nous faire entrer dans la psyché d’un homme malade. Si on se sent mal, alors le livre est efficace.
Ayant tout eu pour réussir notamment la force de travail et un emploi stable, la haine du narrateur envers lui-même et des autres qui ne lui accordent pas d’attention qu’ils croient mériter l’empêche d’avancer. Le texte est alors assez simple à comprendre. Dostoïevski décrit assez bien la façon dont la haine de soi peut se projeter sur les autres. Chaque dispute et hurlement du narrateur semble être un appel à l’aide très, très, très mal exprimé.
Dostoïevski semble assez lucide sur sa propre condition d’homme accro au jeu et sur celle de ces personnages. Pour autant, il ne parvient en aucun cas à contrôler cette rage destructrice qui le dévore de l’intérieur. Le narrateur, miroir de l’auteur (et peu-être du lecteur?) nous rappelle bien à tous que si nous n’allons pas bien, alors nous oscillons entre la négation et la résignantion. D’un côté, le narrateur sait qu’il va mal, qu’il n’a pas à se comporter ainsi avec ses camarades et il voit en Liza une possibilité de rédemption. Mais d’un autre côté, c’est un position confortable auquel il s’est habitué et qu’il ne peut quitter, parce qu’il a peur de souffrir en se confrontant à la vérité.
Il semble qu’il manque une troisième partie à ce livre qui se termine de manière abrupte, mais c’est là le coup de maître. De la même manière que le narrateur qui refuse de continuer à écrire, de découvrir à quel point il va mal et que la confrontation avec la vérité le pousserait à changer, l’auteur Dostoïevski refuse de se confronter lui-même à son addiction au jeu même après la mort de sa femme qui survient au moment de l’écriture du livre.
Ainsi avant de juger l’auteur ou le narrateur, nous devrions nous confronter à notre propre lâcheté face à nos additions qui nous rongent.