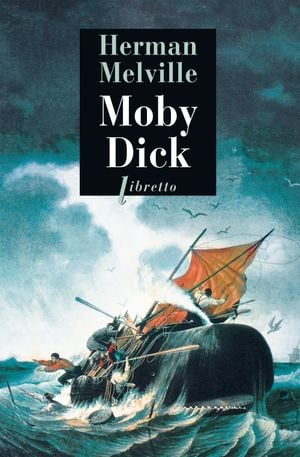« I have writen a wicked book » écrit Melville à son ami Hawthorne en réponse aux louanges de ce dernier au sujet de Moby Dick. A wicked book, c’est le moins que l’on puisse dire pour un livre qui depuis 150 ans représente un mystère impénétrable, insaisissable, inexplicable, un livre qui à l’instar de l’horizon semble s’éloigner d’autant plus qu’on cherche à s’en approcher, et tourne le dos inlassablement à tous les petits malins qui veulent le percer à jour. Art de la savonnette qui n’échappait donc pas à ce diable d’écrivain, et qui n’était certainement pas pour lui déplaire, alors même qu’il continue, devant un tel monstre, à jouer l’innocent : « I have writen a wicked book, and feel spotless as the lamb », si l’on veut la citation en entier !
Énigme persistante, certes, mais qui se paye le luxe d’être en outre polymorphe et changeante : chaque époque, chaque lecteur y aura vu des myriades de paysages, de sens, de poésie, de maléfices, diamétralement opposés et pourtant merveilleusement compatibles. Un simple exemple parmi tant d’autre : comment ce livre a-t-il pu passer à ce point inaperçu ? Comment a-t-il pu devenir aussi incontournable ? Rien ne semble justifier ces deux données inconciliables. Qui paraissent en même temps tellement facile à expliquer. Et n’allez pas croire que c’est parce que le monde a changé, le monde ne change pas (il est changeant, nuance). N’allez pas croire non plus que vous pourrez un jour y comprendre quelque chose : Moby Dick a l’effrayante infinitude des orbes trop polies pour être honnêtes.
Voilà ce qu’a réussi Melville avec son air de ne toucher à rien : inventer la pièce qui tombera toujours du coté pile et face. Ainsi est-il impossible d’être déçu par la lecture du pavé, puisqu’il est justement construit et pensé pour n’être que déception. Tout ce qu’on veut y mettre y est déjà, tout ce qu’on croyait y trouver n’y sera pas, comme si l’important était toujours, et forcément, ailleurs. Mais un ailleurs vu d’ici, prenez-y garde. Car tout est dans tout, et inversement.
Étrange auberge espagnole que celle-là. Dont le patron se fait une joie de vous offrir le tour du propriétaire le plus indigeste qui soit : « Call me Ishmael » and let’s go. Ah, vous avez voulu y voir de plus près ? Préparez vous à une visite aux petits oignons, de la cave au grenier, ou plutôt du fin fond de la soute au sommet du mat de misaine. Et de nouveau, n’allez pas croire qu’Herman y soit pour quelque chose, c’est comme ça, voilà tout : « Et puisque j’ai entrepris de traiter du léviathan, ne m’incombe-t-il pas de me montrer omniscient en la matière et d’épuiser la question ? ». Un auteur symbolique, lui ? Mais enfin, vous n’y pensez pas, il a été marin, il sait de quoi il parle, et vous allez en bouffer, de la graisse de baleine. Un romancier naturaliste ? Soyez sérieux, avec ce capitaine shakespearien qui poursuit un monstre aussi sanguinaire que blanc ? A d’autres. Pourtant cette analyse si fine du capitalisme américain ! Et ce mage persan avec ses prophéties d’outre tombe ? Quand même, ce reportage sur la vie des matelots ? Qui ne sont que de braves pantins lancés à la poursuite du Mal absolu…
À ce petit jeu là, vous ne gagnerez pas contre Herman. Aussi sérieux que facétieux, mélancolique qu’enjoué, brutal que tendre, il a l’arme absolue contre tous les dogmes et toutes les certitudes. Une arme cachée, ou invisible, ou imaginaire, à vous d’aller voir, mais imbattable. Et il la manie comme il se doit : en ne prévoyant qu’une chose, ne surtout rien prévoir, en ne voulant qu'une chose, ne rien vouloir pour de bon.